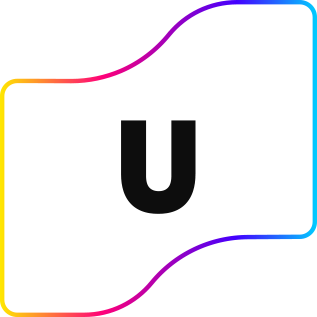Tony-Gandolfini
L’écran noir a ravi son visage, puis dix secondes se sont écoulées dans l’obscurité avant le début du générique. Le géant a alors décollé son immense carcasse du canapé. Un soupir – c’est terminé. Il a beau avoir choisi la chanson d’adieu, Don’t stop believin’, du groupe Journey, il n’écoute plus. Il arrête d’y croire, son long voyage s’achève là. Est-ce ainsi que tout a pris fin ? On l’imagine. Le soir du 10 juin 2007, comme douze millions d’Américains – audience record pour une chaîne câblée –, James Gandolfini est resté chez lui regarder le dernier épisode des Soprano. Il doit être 21 h 30 lorsqu’il voit son personnage non pas vaincre ou mourir, comme il eût été attendu, mais tout bonnement disparaître au moyen d’un artifice dont la rusticité même déconcerte : une simple interruption de programme, le couperet d’un écran noir tombant lors d’un dîner au restaurant alors qu’il relève la tête pour guetter l’entrée de sa fille. Croyant à une panne ou flairant un canular, des fans font très vite crépiter les standards des réparateurs et ceux de HBO. D’autres vont débattre sur les centaines de forums de ligne : l’audace de cette conclusion divise, et divisera durablement. Les enthousiasmes varient, mais la stupéfaction est immédiate : David Chase a trouvé un truc unique pour mettre le point final à la série dont il eut l’idée un jour de 1997. Les travaux et les jours d’un parrain du New Jersey brutal et fébrile, en butte à sa mère – inspirée de Mme Norma Chase –, à son analyste, aux luttes en tous genres : lui-même était sceptique. Trop bizarre ? Trop auto-biographique ? Ce grand anxieux ne se doutait pas que, dix ans plus tard, le MoMA ferait l’acquisition de l’intégrale des six saisons et que Vanity Fair décréterait Les Soprano meilleur programme de l’histoire de la télévision.

James Gandolfini est Tony Soprano
Crédits : HBO 1999-2007
La spirale
Les Soprano sont l’histoire d’un parrain malmené par les servitudes du business et la tyrannie d’une mère au point de devoir se résoudre à consulter un psychanalyste. La démarche contrevient aux principes fondamentaux de virilité et d’omerta ? Tony Soprano n’a pas le choix. Il y va de sa santé, de sa vie peut-être. Telles sont les prémices aujourd’hui mondialement célèbres exposées par le pilote que HBO diffusa le 10 janvier 1999. Tandis qu’il vaque en robe de chambre au bord de sa piscine, Tony a subitement l’impression que de la limonade coule dans son crâne. Il tombe à la renverse et s’évanouit. Les médecins diagnostiqueront une crise de panique ; d’autres suivront, en voiture, dans la cuisine, sur le green… Jennifer Melfi parlera quant à elle de dépression. Tony se rendra désormais à son cabinet de Montclair chaque mardi après déjeuner.
C’est la définition même de ce qui constitue la cruauté des Soprano : la Mafia n’est jamais aussi active que lorsqu’elle paraît en vacances.
Quel est le problème ? La Mafia est d’abord un système de collectes hebdomadaires. Il y eut peut-être à l’origine – cela remonte à un siècle – quelque vraisemblance à la protection que cet argent était censé acheter : un échange de services, un concurrent commercial à écarter, une surveillance policière à déjouer, des voyous qui tournent dans le quartier… Aujourd’hui, c’est autre chose : le paiement réclamé à même fréquence qu’une série télé – ou qu’une analyse – sert d’abord à protéger contre la Mafia elle-même. Le moindre retard dans la remise de l’enveloppe ne manquera pas d’en apporter la confirmation, sanglante de préférence. Les luttes intestines entre familles ne sont à maints égards qu’un aspect de cette circularité première. Tout comme le chevauchement de la vie privée et de la vie professionnelle, les collègues qu’on appelle « oncles » – oncle Silvio, oncle Paulie –, l’autorité déclinante mais considérable encore du véritable oncle Corrado dit Junior, l’ingérence de Livia, la mère, et les manœuvres de Janice, la sœur aînée : la Mafia est une spirale, cela fait bien longtemps qu’elle a liquidé toute différence entre intérieur et extérieur. Elle ne côtoie rien qu’elle n’inclue aussitôt, y compris Carmela et les deux enfants, Meadow et Anthony Junior. La vingtaine de scénaristes supervisés par Chase – pour certains congédiés sans ménagement au terme d’une période d’essai – auront œuvré à éclairer ce fonctionnement en faisant mine de parler d’autre chose que la Mafia. Tony explique à Melfi qu’il travaille dans le conseil en traitement de déchets puis raconte qu’il a pris un café avec un acolyte ? Un montage parallèle le montre tabassant gaiement un créditeur. Accompagne-t-il Meadow pour une tournée des universités de la Nouvelle-Angleterre ? En route, il croise puis étrangle un traître. Cet épisode, le cinquième de la première saison, fut décisif pour l’évolution du rapport de force entre David Chase et les producteurs. Ceux-ci l’estimaient trop noir : selon eux, Chase avait inventé un personnage sans équivalent dans la culture populaire contemporaine, mais en lui faisant commettre un tel crime il s’exposait à perdre tout l’intérêt et toute la sympathie acquis auprès du public. Une négociation s’engagea, mais Chase tint bon. Sa ténacité fut plus tard récompensée : le scénario de « College », coécrit avec Jim Manos Jr., remporta plusieurs prix, dont un Emmy. Le meurtre d’un rat par Tony en marge d’une excursion avec sa fille n’a rien, en effet, d’une coquetterie funèbre. C’est la définition même de ce qui constitue la cruauté des Soprano : la Mafia n’est jamais aussi active que lorsqu’elle paraît en vacances. Son innocence apparente est comme la condition nécessaire de sa culpabilité. Les épisodes et les saisons ultérieurs raffineront le principe. C’est qu’il ne suffit pas d’introduire la fiction d’une extériorité à la Mafia par l’intermédiaire d’un montage parallèle ou de la rencontre de deux lignes narratives. Il faut montrer aussi comment cette fiction passe à l’intérieur de chacun, notamment en soulignant l’impunité dont chacun s’efforce de recouvrir les pires méfaits. Pister les jeux pervers de la mauvaise foi en contexte mafieux : là sera la véritable tâche des scénaristes. Est-ce la faute de Paulie, l’homme aux ailerons d’argent sur les tempes, s’il passe à tabac un héritier, sans motif sérieux ? Est-ce la faute de Janice si l’infirmière unijambiste de sa mère l’accuse d’avoir volé sa prothèse d’une valeur inestimable – vingt mille dollars –, avec pied flexible, botte en veau et absorption des chocs verticaux ? Les intéressés ne le croient pas. Paulie vient d’apprendre que sa mère est en vérité sa tante : on conçoit – même s’il n’est pas homme à le formuler explicitement – que les fils à maman lui tapent sur les nerfs. Quant à Janice, elle se récrie : il faut être vraiment tordu pour insinuer qu’elle irait jusqu’au vol et au chantage pour récupérer une collection de disques italiens ! On ne saurait dire à quelle sphère appartiennent ces incidents, s’ils sont l’essence du business ou le délire de psychologies malades. Si le crime dont ces gens font leur métier occulte à leurs yeux des sadismes plus personnels ou s’ils considèrent au contraire qu’un chagrin justifie bien une rouste, voire davantage. Eux-mêmes ont cessé de s’interroger. Ils se sont faits mafieux, dirait-on, précisément pour ne pas avoir à creuser la signification de leurs angoisses ou de leurs pulsions. Inversement, ils ne sont calculateurs que par conscience professionnelle : nul n’a jamais servi sa Famille sans quelque raffinement dans la terreur. Le tableau est accablant. Enfin, il devrait l’être. Car la confusion des raisons et des effets est telle que chacun peut aussi bien s’estimer le jouet impuissant d’un acharnement du destin. La plus tordue des sœurs et le plus froid des capi ne détestent pas de poser en persécutés. Tony lui-même prend volontiers des airs de victime. A-t-il d’ailleurs absolument tort ? Rien n’est moins sûr. En effet, c’est à un homme pour une fois blanc comme neige qu’Artie Bucco s’adresse, lorsqu’au terme d’une énième histoire de prêt il décrit son ami d’enfance comme un stratège d’exception ayant toujours une dizaine de coups d’avance ! Les ironies du sort sont l’ordinaire des séries télé. Cela se comprend : la monotonie d’un univers précisément circonscrit et la constance de caractères bien trempés appellent irrésistiblement des incidents venant corriger les attentes et relancer les suspenses. Et elles en appellent d’autres, au second degré, pour rétablir ce qui semblait démenti.

Le sourire de Tony
Crédits : HBO 1999-2007
Le retour
Supposons que Bobby « Bacala » Baccalieri ou Johnny « Sack » Sacrimoni vienne rendre visite à Tony dans son bureau du Bing ! Le nounours débonnaire ou le parrain arrogant de New York l’embrasse, s’enquiert de sa santé, de son alimentation… Ça va ? La forme ? Même s’il joue le jeu, Tony se tient sur ses gardes. Il sait bien qu’une accolade peut être l’indice d’une trahison, un sourire l’aveu d’un coup tordu. Ces deux-là sont ses collègues, ils travaillent avec lui, mais ils travaillent surtout pour eux-mêmes. Aucun risque qu’ils oublient de se servir au passage ou de développer leurs petites affaires dans leur coin. Ne nous illusionnons pas : ils ont quelque chose derrière la tête. Tony est pareil : sauf la fois où Artie le lui reproche, il calcule tout le temps. S’il avance une pièce, c’est sans doute en réponse à un coup de « Sack », de « Bacala » ou d’un autre. C’est plus sûrement encore une réponse différée à un de ses propres coups, qu’il a peut-être oublié entre-temps. L’homme qui rejette volontiers sur le monde entier la responsabilité de ses crimes est donc aussi confronté sans arrêt à des situations lui renvoyant son propre reflet.
L’obligation d’y retourner encore et toujours fut sans doute aussi pénible aux scénaristes qu’à Tony-Gandolfini.
Quelle attitude adopter dans de telles circonstances ? Aucun péril n’est si grand, pour un parrain, que celui d’être trahi par ses émotions. Sans doute le flou de sa face peut-il, chez Tony, maquiller le soupçon en écoute et l’inquiétude en disponibilité. Mais cela ne marche qu’un temps. Les yeux s’humectent, la vision se brouille… : chacun voit vite que rien ne le laisse indifférent. Tout l’atteint, tout le requiert, tout lui parle – son humidité est celle d’une éponge. Le tourment est donc ici l’envers d’un talent : la sensibilité extrême qui aiguise l’intelligence de Tony pourrait bien un jour précipiter sa fin. Tony Soprano est au premier chef affecté par la série qui porte son nom. Il en est le premier otage, la première victime. Il s’agit ici d’une autre propriété du genre que la Mafia selon Chase a su pousser à son comble. La dépendance que celui-ci cherche à obtenir chez ses spectateurs n’est pas un effet extérieur. Elle ne fonctionne qu’à condition d’être d’abord ressentie de l’intérieur par leurs personnages principaux. Tony est un addict, il est pris dans un tourbillon de travail, de violence et de paranoïa toujours plus rapide et profond. Il ne veut pas y aller, il en a marre. Tant pis : il faut qu’il y retourne. Il le faut d’autant plus qu’il est essentiellement une créature du retour. Chaque épisode le répète, mais peut-être aucun avec autant de fermeté que le premier de la cinquième saison. Carmela et Tony se sont séparés. Celle-ci ayant repéré qu’un ours rôdait dans les parages de la maison, Tony est toutefois autorisé à revenir provisoirement pour veiller devant la porte, un fusil mitrailleur à la main et son éternel cigare aux lèvres. De quoi est-il alors le gardien, sinon de lui-même ? De la menace qu’il représente pour son épouse ? Mais aussi du retour au domicile conjugal, qu’il effectuera pour de bon à la fin de la saison, au terme d’une longue marche dans la forêt enneigée ? On peut voir l’addiction télévisuelle comme le contraire de la projection cinématographique. Elle ne s’en va pas au plus loin, elle revient. Aucun saut hors de soi vers des horizons plus cléments, rien d’autre qu’une succession de retombées ressemblant à un piétinement. Aucune prise, que des reprises. Les derniers épisodes s’ouvriront volontiers par un gros plan de Tony endormi, bientôt réveillé : allez, encore un effort. Un effort pour faire quoi ? On ne se pose même plus la question. Passé un certain stade, Tony n’est plus que l’envoyé du programme hebdomadaire. Il est donc logique qu’il nourrisse l’espoir de pouvoir, à l’inverse, tout recommencer à zéro. Tony se passe la main sur le visage pour évacuer ses idées noires. Le jour va venir où il aura enfin le visage net. Ce sera le matin, il fera beau et clair, il vaquera paisiblement dans son jardin. Tragique naïveté : en fait d’aurore il n’y aura pour lui que celle, toujours identique, de chaque nouvelle saison, la robe de chambre élimée, la mine sale, le journal à aller chercher au bout de l’allée. Ne nous étonnons pas de le voir s’effondrer au bord de la piscine. Étonnons-nous plutôt que ses syncopes ne soient pas plus fréquentes. L’obligation d’y retourner encore et toujours fut sans doute aussi pénible aux scénaristes qu’à Tony-Gandolfini. Mais ceux-là n’attendirent pas jusqu’au 10 juin 2007 pour souffler. On peut dater au milieu de la troisième saison le moment à partir duquel les rimes cessent de se réduire à illustrer la circularité mafieuse et s’efforcent de paraître involontaires, voire immanentes.

Tony touche le fond
Crédits : HBO 1999-2007
Couverture : James Gandolfini dans Les Sopranos, de David Chase.