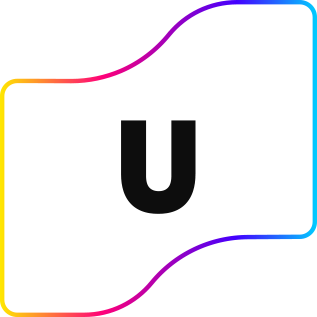Genèse d’un média
Pouvez-vous nous raconter comment vous avez imaginé Narratively ?

Love in an elevator, par Abby Ronner
Crédits : Narratively / Elizabeth Herman
« Nous nous retrouvions dans les bars de Brooklyn pour tenter de mettre en forme ce que Narratively allait devenir. »
La dernière chose importante à ce moment-là, c’était que le paysage médiatique était en train de changer : les gens lisaient d’une nouvelle manière, l’iPad avait été inventé et le long format retrouvait du sens sur internet. Les gens commençaient à vouloir bien plus que de l’agrégation de contenu et des gros titres. C’était le moment idéal pour moi. Il fallait que je concrétise mon idée à cette période précise, sinon je ne le ferais jamais. C’est là que je me suis dit que si je ne trouvais pas quelqu’un pour m’aider et pour m’encourager, je n’arriverais pas à créer le média non plus. J’ai donc approché Randon Spiegel qui est le cofondateur et le directeur éditorial de Narratively. Nous nous retrouvions dans les bars de Brooklyn pour tenter de mettre en forme ce que Narratively allait devenir. Nos réunions en duo prenaient de l’ampleur : six, puis quinze, puis vingt-cinq, puis soixante personnes nous rejoignaient pour discuter. Nous avons donc prévu un lancement en septembre 2012 parce que j’ai réalisé que nous nous asseyions dans des bars branchés, nous buvions beaucoup de bières et nous mangions beaucoup de pizza, et que nous aurions pu discuter du projet jusqu’à la fin de notre vie sans jamais rien faire de concret. Il fallait passer de la réflexion à l’action. Nous avons commencé à faire des reportages tout en lançant notre campagne de financement sur Kickstarter à l’été 2012, qui nous a permis d’obtenir 54 000 dollars et de lancer le site à la fin de la campagne. Vingt mois après, nous avons une communauté de 800 contributeurs dans le monde entier, réalisateurs, auteurs, photographes, illustrateurs, animateurs, designers… et ce nombre augmente à mesure que notre popularité grandit. Chaque jour, de plus en plus de personnes nous demandent comment elles pourraient s’impliquer, si elles peuvent rejoindre notre liste de diffusion qui annonce les prochains thèmes hebdomadaires etc. C’était un voyage incroyable et nous avons encore tellement à faire. Nous sommes très optimistes.
Après deux années d’existence, est-ce que le média est allé dans la direction que vous souhaitiez ?
Évidemment, il y a eu des surprises. Beaucoup de bonnes surprises d’ailleurs ! Du côté business notamment. Par exemple, avant de se lancer, j’ai écrit un business plan avec toutes mes idées sur comment gagner de l’argent, comment arriver à l’équilibre etc. Les premières idées que j’ai couchées sur le papier évoquaient un revenu publicitaire, de la vente de contenu à nos partenaires, un abonnement payant pour les lecteurs… En fait, nous n’avons pas gagné d’argent avec tout ça. Nous avons fait un peu de publicité et cela fonctionne mieux maintenant que notre audience est plus large, mais la plupart de nos revenus viennent des prestations que nous réalisons pour des clients. Nous avons un groupe de travail sur Narratively et nous utilisons le talent de nos contributeurs pour produire des textes de grande qualité pour d’autres médias et pour des marques. Par exemple General Electrics avait un nouveau produit qui allait sortir et ils avaient besoin d’une histoire pour en faire la promotion. Ils nous ont donc engagé pour que l’on produise une narration, avec une animation etc. Ce n’est pas une histoire que nous avons publié chez nous : nous l’avons vendue au client et c’est lui qui s’est chargé de la diffuser. C’est un moyen pour nous de faire un travail créatif qui paie beaucoup plus que le travail éditorial. Nous sommes maintenant également en train d’imaginer un abonnement payant.

The clubhouse that folk built, par Jocelyn Arem
Crédits : Narratively
Nous voyons naître beaucoup de médias aux États-Unis. Pensez-vous que le paysage médiatique est en train de se redessiner ?
Absolument ! Le type d’histoire que beaucoup d’entre nous produisent est nommé du « long format ». Bien entendu, ce n’est pas quelque chose de nouveau, on écrit de longs articles depuis des décennies : Tom Wolfe, Norman Mailer, les journalistes du New Yorker, etc. Ce qui est nouveau, je pense, c’est l’enrobage. Nous pouvons produire du contenu de très grande qualité et le distribuer sur de nouvelles plateformes, sur les réseaux sociaux. Je peux écrire une histoire aujourd’hui qui se passe à New York, la tweeter et donc faire en sorte qu’elle atteigne des lecteurs dans le monde entier qui pourront la partager. C’est un cercle infini, qui fait plusieurs fois le tour du monde. La manière de produire, partager et distribuer une histoire, d’y intégrer de nouveaux éléments, des visuels très larges, du défilement infini ou en paralaxe, tout cela est incroyable. Je pense que toutes ces choses nous font avancer vers des histoires plus plaisantes à lire et quand nous regarderons derrière nous dans cinq ans, nous rigolerons peut-être de ce que nous sommes en train de faire maintenant car on peut imaginer que nous aurons des moyens encore plus intéressants pour raconter des histoires. Mais je pense que le storytelling, en tant que genre radicalement différent de l’actualité ou du scoop, est une forme durable. Nous créons des textes que l’on pourra peut-être lire dans cinq ans et qui auront toujours du sens. Ils n’ont pas de date de péremption.
« Ce qui est vrai aussi, c’est que nous avons maintenant des agrégateurs avec qui travailler : Longreads ou Longform.org. Ils diffusent les meilleures histoires qui existent sur Internet. »
Avec un peu de chance, nous aurons de plus en plus d’outils à utiliser pour ré-éditer ces histoires et leur donner une nouvelle vie. Je travaille déjà sur un moyen de redonner de la visibilité aux histoires que nous avons publiées il y a un an et qui sont toujours d’actualité. Peut-être sous la forme d’ebooks ou d’une édition imprimée. Il est aussi possible de faire des événements live pour rencontrer les auteurs des histoires. Nous faisons également parfois des mises en avant thématiques de nos histoires : à la Saint Valentin, nous pouvons rediffuser des histoires à propos d’amour et de haine. C’est une des grosses difficultés des plateformes de publication numériques : une fois qu’une histoire est sortie, elle est sortie et c’est très difficile de continuer à la faire vivre. Ce qui est vrai aussi, c’est que nous avons maintenant des agrégateurs avec qui travailler : Longreads ou Longform.org. Ils diffusent les meilleures histoires qui existent sur internet. Ils sont très importants pour nous en tant qu’éditeurs de contenu, parce qu’ils peuvent nous aider à promouvoir nos histoires et permettent aux lecteurs d’arriver directement à l’essentiel, à ce qui s’est fait des mieux. Que ce soit de très gros comme Digg ou d’autres, plus spécialisés comme Longform, on voit tout de suite leur intérêt et leur impact sur notre audience.
Une semaine, un sujet
Comment concevez-vous votre ligne éditoriale ? Comment choisissez-vous un sujet pour une semaine ?
En fait, c’est la partie la plus intéressante de notre boulot ! Nous décidons de la ligne éditoriale de plusieurs manières. La procédure standard, c’est d’envoyer un mail à nos contributeurs toutes les deux ou trois semaines en leur proposant quatre ou cinq thèmes. Rédemption, challenges… des idées abstraites, d’autres plus concrètes. Ensuite, les gens nous envoient des histoires. Elles ne sont pas toutes nouvelles : une histoire pourrait avoir été écrite il y a sept ou huit ans et n’avoir jamais trouvé un endroit pour être publié. C’est la même chose pour les vidéos : les documentaires que nous recevons sont souvent terminés et n’ont pas reçu suffisamment d’exposition. Parfois, nous recevons des histoires sans les avoir demandées. Quelqu’un nous dit : « Hé, j’ai une histoire qui est terminée, sur ce personnage génial à Berlin, est-ce qu’elle pourrait entrer dans l’un de vos thèmes ? ». Quand nous apprécions l’histoire, il nous arrive de construire un thème à partir d’elle. Nous avons une trentaine d’histoires en stock que nous n’avons pas encore publiées : ce sont d’excellentes histoires que nous voulons diffuser, mais nous n’avons pas encore eu de thème pour les accueillir. Il nous arrive de regarder cette liste, de voir quelques textes qui ont un point commun et de trouver un thème qui pourrait les rassembler.
« Au début, nos auteurs étaient des amis à moi, des gens que j’avais rencontré au New York Times par exemple ou à GQ. Je leur disais ce que j’allais faire et ils me répondaient qu’ils trouvaient ça génial et qu’ils voulaient bien en faire partie. »
Et comment trouvez-vous les journalistes et auteurs pour écrire des histoires qui correspondent à vos attentes ?
Nous avons un processus éditorial assez rigide. Au début, nos auteurs étaient des amis à moi, des gens que j’avais rencontré au New York Times par exemple ou à GQ. Je leur disais ce que j’allais faire et ils me répondaient qu’ils trouvaient ça génial et qu’ils voulaient bien en faire partie. Je choisissais un peu à la main les gens avec qui j’allais travailler. Nous, journalistes, nous avons tous des histoires laissées de côté que nous avons envie de raconter sans en avoir le temps ou l’espace dans un média. Nous cherchons à offrir une solution pour ces problèmes. Les premiers contributeurs étaient donc des amis et des amis d’amis. La deuxième vague est arrivée quand le magazine Capital New York a écrit à notre sujet un article très élogieux. Cela disait quelque chose du genre : « Des pigistes du New York Times veulent sauver la narration, histoire après histoire ». Grâce à cet article, des gens sont venus nous voir parce qu’ils souhaitaient s’impliquer dans le projet. Après, quand nous avons lancé le Kickstarter, nous avons commencé à toucher des gens dans le monde entier. Certains nous demandaient si cela nous intéressait des histoires issues d’un voyage à Londres ou à Berlin ou si nous nous focalisions uniquement sur New York. L’idée initiale, c’était que Narratively ne publierait que des histoires new-yorkaises et qu’il y aurait des sites indépendants sous six à huit mois pour Los Angeles, Chicago, Paris, Londres. Sauf que les gens voulaient raconter ces histoires tout de suite. Et cela aurait coûté beaucoup de temps et d’argent de faire tous ces sites ! Nous nous sommes rendus compte que le lieu n’était pas la chose la plus importante : nous faisions des histoires à propos des gens, qui interagissent avec d’autres gens et qu’importe l’endroit où ils vivent. Il nous fallait une approche plus globale de la question. Plus je fais de conférences, dans des universités ou des groupes de recherche, plus je trouve de gens intéressés. Les histoires aussi attirent, d’elles-mêmes, tout comme les partenariats avec des médias plus conséquents, comme Buzzfeed ou Digg.
Vous choisissez tout de même de montrer le lieu où se déroule l’article et le temps de lecture sur votre page d’accueil. Pourquoi sont-ils importants pour vous ?

The Great Canadian Hoops Hope, par Sam Riches
Crédits : Narratively
Vous n’avez d’ailleurs jamais choisi de format, tout semble exploité sur Narratively. Pensez-vous qu’une histoire a un format dans lequel elle s’exprime mieux que dans tous les autres ?
Oui, bien sûr. L’une des promesses que nous avons faites au lancement de Narratively, c’est de ne pas être figés dans un seul et même format. Nous voulions pouvoir raconter des histoires dans le format qui serait le plus adapté au contenu. J’ai fait ce choix parce que je détestais allumer la télévision et tomber sur le correspondant local d’une chaîne et qui commençait son texte absurde, « Oui c’est John en direct de… », et qui tentait de dire en dix mots une histoire qui aurait demandé à être écrite en plusieurs milliers. Nous voulons rendre justice à toutes les histoires et pour cela, il ne faut pas les emprisonner dans un style ou un format particulier. Cela dit, je dirais que les trois quarts de nos histoires sont du texte, avec des illustrations ou des photographies. Une ou deux fois par semaine, nous essayons de faire quelque chose d’un peu plus multimédia, que ce soit une vidéo, une bande dessinée ou un reportage audio. Faire de la vidéo par exemple, cela nous amène une audience toute différente, aussi bien du côté des gens qui créent du contenu que de ceux qui le consultent. Et puis même si une histoire a toujours différents moyens d’être racontée, nous souhaitons trouver le meilleur. Certaines ont besoin de photographies. Des fois, il y a du mouvement, des sons, de l’énergie que vous ne pouvez pas saisir avec des mots. D’autres fois, la qualité de la prose et le lyrisme du phrasé font briller l’histoire.
Journalisme et business
Pourquoi avez-vous choisi Marquee pour votre concevoir votre site ? C’est plutôt original.
Nous avons lancé le site sur WordPress au début et c’était très bien. Peu après, Marquee nous a contacté pour nous expliquer ce qu’ils faisaient : ils construisaient un CMS pour les gens comme nous. Ils avaient un produit qui pouvait faire apparaître nos histoires dans toute leur beauté. Nous avons accepté et nous avons pu travailler avec eux : ils nous ont offert un support que l’on n’aurait pas pu imaginer avoir avec WordPress. Ils nous voyaient comme un partenaire logique et c’était la même chose de notre côté.
« Je crée des choses depuis longtemps maintenant. Quand j’étais à l’université, j’ai fait un magazine vidéo d’actualité d’une soixantaine de minutes : j’étais le producteur, l’éditeur, le présentateur. »
Pour être honnête, il y a eu quelques difficultés, parce que c’est une startup et que les choses que nous aurions aimé avoir dans l’heure pouvaient prendre des semaines à être faites. Mais c’est quelque chose que nous avons accepté. Maintenant, nos deux entreprises ont évolué ensemble et continuent de travailler ensemble. Nous travaillons même pour des clients communs, récemment pour une organisation à but non lucratif de Washington DC. Ils lançaient la version web de leur magazine et nous avons de notre côté produit le contenu, quand Marquee s’occupait du développement de la plateforme. C’est une belle entente !
Vous êtes un journaliste de formation. Était-ce difficile de passer du côté du business des médias ?
Eh bien peut-être pas dans mon cas, c’était une transition assez naturelle. Je viens d’une famille d’artistes et d’entrepreneurs. Depuis que je suis tout jeune, on me dit de suivre mes passions et de développer mes compétences. Je crée des choses depuis longtemps maintenant. Quand j’étais à l’université, j’ai fait un magazine vidéo d’actualité d’une soixantaine de minutes : j’étais le producteur, l’éditeur, le présentateur. Même plus jeune, j’étais le capitaine de mon équipe de football. J’ai toujours aimé être un leader et écrire des histoires. J’ai lancé la partie numérique des médias dans lequel j’étais. Que ce soit pour moi ou pour des compagnies plus grandes, j’ai toujours lancé et créé des services. J’ai toujours eu cette envie d’entreprendre. Narratively, c’était une progression plutôt naturelle, du coup. Je pense que promouvoir le site, parler des choses que nous faisons, c’est aussi quelque chose que je fais depuis longtemps, à peu près depuis le moment où j’ai rencontré le cofondateur du site : déjà, je lui vendais mon idée. Je n’ai eu qu’à faire la même chose avec d’autres personnes qui m’ont ensuite accompagné. C’est à peu près la même chose quand je parle à des partenaires, des clients ou des publicitaires : je passe maintenant plus de temps sur la partie business, même si je suis encore bien impliqué côté éditorial. Les premiers mois, j’éditais les histoires et j’en écrivais beaucoup plus : dans un sens, cela me manque, parce que je suis un professionnel de l’écriture. Mais d’un autre côté, mon travail est beaucoup plus diversifié maintenant. C’est une sorte de courbe d’apprentissage, depuis le moment où je lançais des magazines pour des grosses structures, jusqu’au moment où j’ai eu tout à faire moi-même. Je pense que l’on apprend toujours et que nous devenons toujours meilleurs, mois après mois, ce qui nous permet ensuite de grandir. C’est un cercle vertueux plutôt plaisant.
Vous avez participé à une conférence pour WNPR News au sujet de l’âge de la distraction. Est-ce que la lecture d’œuvres non fictionnelles peut distraire ? À quel moment considérez-vous que l’information s’arrête ?

The chocolatier for the Hip-Hop ear, par Marjorie Hernandez
Crédits : Narratively
Avez-vous appris des choses sur le journalisme en commençant à publier les textes d’autres personnes ?
Oh oui ! J’aimerais parfois revenir en arrière et retrouver des choses que j’ai écrites à l’université, mais dans le même temps, je me dis que ce n’est peut-être pas une bonne idée. (Rires.) Je pense que c’est intéressant de regarder en arrière et de saisir sa propre évolution. Quand j’ai commencé à travailler pour le New York Times, je me suis retrouvé à quatre heures du matin à couvrir un double homicide, un incendie ou à interroger un homme politique avec des questions auxquelles il ne peut pas répondre. Ce n’est pas ce que je veux faire, l’actualité chaude, mais j’ai appris, en faisant ce type de reportage, à poser les bonnes questions, à apprendre à garder ses positions, éthiques et journalistiques. Plus je pense à Narratively, à ce que j’ai fait en tant qu’entrepreneur, plus je me rends compte que j’ai été aidé par mon passé de journaliste. J’ai une meilleure idée de ce dont les journalistes ont besoin, des outils qu’ils pourraient utiliser pour raconter leurs histoires. Venir moi-même de ce monde m’a beaucoup aidé : même si je suis maintenant un entrepreneur, je reste un journaliste au fond de moi.
On entend parfois en France que les gens ne lisent plus… qu’en pensez-vous ?
« Je pense que les histoires qui fonctionnent sont celles que vous allez relire avec plaisir dans cinq ans. Vous ne relirez jamais une actualité. »
Oh, nous entendons ici aussi que l’attention se réduit, que les gens perdent leur intérêt pour la lecture etc. La réalité, c’est que lorsque vous avez une histoire qui est une fenêtre ouverte vers ces mondes inconnus, qui vous forment, vous illuminent, vous passionnent… on constate l’exact opposé. L’une des histoires les plus populaires de Narratively sur la gentrification de Brooklyn vient de gagner un award : elle fait à peu près 70 000 mots… elle a reçu près de 15 000 likes sur Facebook. Alors oui, on pourrait avancer que les gens ont liké sans lire, mais jusqu’à preuve du contraire, on peut dire qu’ils ont ressenti le besoin de partager cette histoire, d’en parler. La quantité ne fait pas tout, évidemment : vous pouvez aller dans un restaurant parisien, payer 150 euros et avoir un repas atroce, tout comme vous pouvez avoir une histoire de 20 000 mots sans aucune saveur. Je pense que les histoires qui fonctionnent sont celles que vous allez relire avec plaisir dans cinq ans. Vous ne relirez jamais une actualité.
Couverture : The Spontaneous World of a Roman street circus, par Andrea Menozzi, Silvia Landi & Violetta Canitano