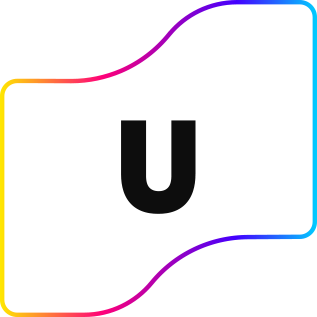Un livre d’évasion
À l’aube de mon adolescence, tandis que s’éveillait mon intérêt pour les montagnes et l’alpinisme, mon père m’offrit pour mon anniversaire un livre intitulé High Conquest. Un journaliste Américain diplômé de Princeton du nom de James Ramsey Ullman l’avait écrit. Lui qui s’était déjà modestement adonné à l’alpinisme dans les Alpes était tombé amoureux des montagnes. Le livre fut publié en 1941, deux ans après le début de la guerre en Europe, et très peu de temps avant l’entrée des États-Unis dans le conflit. Dans son avant-propos, M. Ullman déclare être bien conscient du contexte. Il écrit : « Dans un tel monde [un monde en guerre], un livre qui se rapporte aux montagnes et à l’alpinisme, pour le bien de tous, ne peut que être catalogué de “livre d’évasion”. Et, dans un sens, c’est exactement ce qu’il est. La « conquête » dont il est question dans son titre est à des années lumières de celle qui, sanglante et irréfléchie, s’abat sur la Terre aujourd’hui ; et les aventures humaines qui le composent ont peu de choses à voir avec les dictateurs et généraux, les Divisions Panzer et la chute des nations. Elles n’ont également rien à voir avec la désillusion, le désespoir et la peur. » Ullman était, pour rester poli, un écrivain saisissant. Plus grossièrement, il était un romantique, souvent porté par une prose boursoufflée et parfois évasive. Lorsque je lus son livre pour la première fois, j’étais encore bien trop crédule pour le réaliser, et il fut pour moi une source d’inspiration. Aussitôt, l’idée germa dans mon esprit qu’il me fallait au moins voir de mes propres yeux les dix plus hautes montagnes du monde, qu’encore personne, en 1941, n’avait gravi. J’imagine que j’étais l’un des quelques élèves de 1ère de la ville de Rochester, dans l’État de New York, à pouvoir parler de la tentative d’ascension de l’Everest, en 1924, par George Leigh Mallory et Andrew Irvine, au cours de laquelle ils se volatilisèrent, quelque part sous le sommet. Le géologue Noel Odell, qui les assistait d’en bas, pensa les apercevoir se diriger vers la crête nord avant de les voir disparaitre dans les nuages. Longtemps après ma lecture, j’eus la chance de pouvoir questionner l’alpiniste Britannique Eric Shipton. Il avait mis les pieds à l’endroit même où Odell s’était trouvé, et distingua les deux formations rocheuses qu’Odell avait dû distinguer lui aussi. J’eus également la chance de demander à de nombreux alpinistes de ma génération leurs sentiments sur le livre d’Ullman. Beaucoup d’entre eux s’avérèrent tout aussi inspirés que moi. Soit dit en passant, au cours des décennies, je parvins à voir de mes yeux les dix plus hautes montagnes du monde.

Vue sur la chaîne des montagnes de Rwenzori
Crédits
À cause de l’humidité, des marais se forment aux abords des montagnes : une boue spongieuse et suintante qui avale littéralement les pieds de ceux qui tentent de la traverser.
Avant d’aller plus loin dans l’histoire de ces montagnes, j’aimerais faire un point sur ce qui avait attiré mon attention dans le livre d’Ullman. Quelques éclaircissements sont nécessaires. Le Ruwenzori – désormais officiellement appelé Rwenzori, je m’expliquerai plus tard – est une chaîne de montagnes qui délimite la République Démocratique du Congo et l’Ouganda. Elles s’étendent à quelques 120 kilomètres le long de la vallée du Rift est-africain, à une largeur d’environ 64 kilomètres. Au nord se trouve le Lac Albert, au sud le Lac Edouard et à l’est le Lac Victoria. La chaîne est constituée de six massifs qui, scindés par des gorges profondes, rendent la traversée très difficile. Plusieurs sommets culminent à plus de 4 876 mètres. Le Mont Stanley – dont j’expliquerai aussi le nom plus tard – désigne une des cimes parmi le massif que l’on distingue. Neuf d’entre elles culminent à plus de 4 876 mètres. Le plus haut, et le plus haut de tout le massif, est le pic Marguerite, à 5 109 mètres. Les hautes montagnes sont toujours gelées, quoique les glaciers fondent rapidement et disparaitront probablement dans quelques années, à l’instar des neiges du Kilimandjaro. Le climat est une caractéristique déterminante du massif. La pluie tombe d’ordinaire environ 350 jours par an. À des altitudes de 2 700 ou 3 050 mètres, la hauteur des précipitations annuelles est supérieure à deux mètres. Les seules périodes de sécheresse se produisent quelques semaines durant, entre fin décembre et début janvier, nommées par les Congolais francophones « la petite période de sécheresse ». Les gens qui bravent le massif déclarent, et ce une grande partie de l’année, être littéralement submergés. Et même lorsqu’il ne pleut pas, l’air lourd et humide qui s’élève des plaines marécageuses se condense dans un épais brouillard qui voile les montagnes. Dans cette brume, à moins d’avoir une boussole, les gens qui essayent de naviguer à travers les glaciers se retrouvent totalement désorientés. À cause de l’humidité, des marais se forment aux abords des montagnes : une boue spongieuse et suintante qui avale littéralement les pieds de ceux qui tentent de la traverser. Et même en voulant se déplacer sur les rochers ou les rondins qui dépassent du marécage, personne n’est à l’abri, tant ils sont glissants, de se tordre une cheville… ou pire encore. Voilà donc ce qu’il faut avoir à l’esprit en lisant Ullman. L’expédition fut initiée au port de Naples, avec pour idée d’arriver au pied des montagnes en juin : selon les recherches du Duc, le temps pourrait être relativement sec à cette époque. Le premier arrêt était programmé au port de Mombassa, dans l’Océan Indien. De nombreuses personnes s’étaient jointes au groupe. En plus de Sella et Pettigax, il comprenait un assistant photographe, trois autres alpinistes professionnels originaires d’Aoste, et le cuisinier personnel du Duc, Igino Igini. Un chemin de fer pouvait maintenant les emmener au Lac Victoria en passant par Nairobi. Une fois à Port Florence, sur le lac, ils entreprirent la suite de l’expédition en bateau. Le 7 mai ils débarquèrent à Entebbe, un protectorat britannique de l’Ouganda. La prochaine étape consistait à rejoindre Fort Portal, nommé d’après Sir Gerald Portal, qui avait été le commissaire britannique de l’Ouganda. L’expédition, en incluant tous les porteurs, était maintenant composée de quelques quatre cents personnes. Il fallut 15 jours de marche au groupe maladroit pour couvrir les 290 kilomètres qui séparaient Entebbe de Fort Portal. De temps à autre il est possible de distinguer les montagnes du Ruwenzori depuis la ville et les environs du Lac Albert, telles des fantômes dans l’horizon. Là-bas, le Duc rencontra deux groupes, dont un du British Museum, tout juste rentré après avoir tenté de gravir les plus hauts sommets du Ruwenzori. Chacun avait fait son chemin en suivant les conseils de chasseurs locaux, par la vallée de la Moboku. Plus tard, elle fut nommée « Glacier de Moore », d’après le naturaliste J. E. S. Moore qui, en 1900, en suivant la même vallée, parvint à grimper à une altitude d’environ 4 541 mètres sur le Mont Baker, un autre groupe de sommets dont le plus haut, Edouard, culmine à 4 842 mètres. Pour le Duc, le problème était que ce chemin, le long de la vallée de la Moboku, ne menait pas directement aux plus hauts sommets du massif : ceux du Mont Stanley. Il longea alors le fleuve Mokubu jusqu’à une jonction avec le fleuve Bujuku, mais décida de continuer son chemin. En descendant, il réalisa que s’il avait longé le fleuve Bujuku, la route aurait été bien plus directe. Désormais, c’était la route habituelle. C’est en décrivant l’ascension le long de la vallée que la prose d’Ullman me captiva, tant elle irradiait. Il écrit : « La région dans laquelle pénétraient alors ces alpinistes-explorateurs était d’une étrangeté et d’une sauvagerie incroyables. Un monde cauchemardesque de jungle, de brouillard et de pluie. Les gorges du Mokubu s’enchevêtraient dans une végétation en décomposition, une étendue sauvage étranglée, à travers laquelle ils devaient se frayer un chemin, pas après pas. Les hommes et bêtes de somme pataugeaient à genoux dans la boue et la moisissure, tandis qu’à travers la voute des cimes feuillues la pluie s’abattait sans relâche sur eux. » Si l’on lit le récit véritable de l’expédition, on s’aperçoit qu’aucune bête de somme n’était employée à ce moment. Tout le matériel était hissé par les porteurs.

La chaîne du Rwenzori depuis l’Ouganda
Crédits
La Montagne de la Lune
Quiconque a vécu en Égypte a dû s’interroger sur le mystère qui entoure le Nil. La saison des pluies, quelle qu’elle soit, se produit entre les mois de novembre et mars, tandis que c’est en septembre, lorsque le climat est sec, que le fleuve déborde. Cette crue, propice à la fertilité des sols, est essentielle à l’agriculture égyptienne. Le fleuve s’écoule vers le nord du désert. La question évidente est donc : d’où provient cette eau ? Déjà au sixième siècle avant notre ère le génie universel grec Aristote suggérait qu’elle proviendrait d’un massif montagneux lointain et « argenté ». Les Grecs avaient bien conscience que la fonte des neiges pouvait être la source des eaux fluviales. Un siècle plus tard l’historien grec Hérodote, dans le second volume de ses Histoires, écrit qu’il avait appris d’un scribe dans la ville égyptienne de Saïs que « entre Syène, près de Thèbes, et Eléphantine, s’élevaient deux montagnes en forme de cône appelées Crophi et Mophie [de magnifiques noms] ; et que c’était entre elles que les sources du Nil, d’une immensurable profondeur, prenaient naissance », même si Hérodote avertit le lecteur que son expérience ne lui permettait pas d’attester de la véracité l’information. Il existe cependant bien une carte élaborée par l’astronome grec et mathématicien Hipparque, datant de l’an 100 avant notre ère, qui montre que le Nil tire son origine de trois lacs proches de l’équateur. Le fondement de cette information n’est pas clair. Le nom de « Montagnes de la Lune » n’est mentionné nulle part : cette appellation arriva 300 ans plus tard.
Ptolémée parle de to tes Selenes oros – Montagne de la Lune. Enfin. La première mention des Montagnes de la Lune.
D’origine grecque, Claude Ptolémée vécut à Alexandrie. Sa vie demeure une énigme, mais les dates délimitant sa vie sont à peu près comprises entre 100 et 170. Il était un génie encyclopédique. Difficile de croire qu’un seul individu soit capable de manifester autant de pensées originales. Parfois, il est affirmé qu’il était aussi bien un compilateur qu’un inventeur : il compila ou inventa la théorie du géocentrisme de la Terre qui perdura jusqu’à l’arrivée de Copernic et Kepler. Même s’il écrivait en grec, il devînt célèbre plus tard grâce à la traduction arabe de son œuvre Almageste, qui fut traduite à son tour en latin. En plus de son travail en astronomie, il publia Géographie, et son modèle pour dessiner les cartes servit de base pour les 1400 années à venir. Voici sa suggestion concernant la source du Nil : « À une latitude de 12”30’, entre les longitudes 57° et 67°, s’élève la Montagne de la Lune, dont la neige abreuve les lacs desquels proviennent les sources du Nil. » Glen Bowersock, professeur d’Histoire Ancienne à l’Institut d’Étude avancée de Princeton, m’avait informé que la copie originale en grec de Géographie existait. Dedans, Ptolémée parle de to tes Selenes oros – Montagne de la Lune. Enfin. La première mention des Montagnes de la Lune, mais au singulier. En excluant les coordonnées géographiques des lacs, qui ne correspondent à aucun des lacs existants, il reste cette histoire de nom. D’où venait-il ? Personne ne le sait. On suggéra une erreur de traduction de l’arabe : l’arabe utilisa le mot « gamar » qui veut dire « lune ». Mais « agamar » peut vouloir dire « blanchâtre ». Y a-t-il eu confusion ? Peut-être aurait-il fallu parler de « Montagne Blanchâtre » – beaucoup moins poétique mais bien plus sensé. Les traductions latines optèrent toutes pour Montes Lunae – le pluriel – qui apparaît désormais sur les cartes. Mais cela ne répond pas à la question des sources du Nil.

Début de l’ascension
Crédits
Stanley & Livingstone
Sa biographie est aussi énigmatique que les montagnes elles-mêmes. Enfant illégitime né le 28 janvier 1841 au Pays de Galles, sous le nom de John Rowlands – patronyme de son père – il fut abandonné par ses parents et vécut avec son grand-père maternel. À la mort de son grand-père, lorsqu’il avait six ans, il fut confié à la St. Asaph Workhouse (N.d.T institution publique britannique du XIXe siècle où les pauvres étaient logés en échange de leur travail), où il reçut une décente éducation. Il quitta l’institution de son plein gré. Le récit de sa vie à l’époque de Dickens, comme beaucoup d’autres choses, demeure incertain, mais il prit pour sûr le large à l’âge de 17 ans. À l’époque, il était monnaie courante de voir les capitaines de bateau, sans scrupules, rendre la vie de l’équipage si intolérable qu’ils quittaient le navire sans récolter leurs salaires. C’est ce que Stanley fit à la Nouvelle Orléans, où il offrit ses services à un négociant en coton du nom d’Henry Stanley, auquel il emprunta son nom. Il ajouta « Morton » plus tard. Dans son autobiographie, Stanley inventa l’histoire de la mort du véritable Henry Stanley et de sa femme.

Premières neiges
Crédits
« Je vis un nuage d’une forme toute particulière, de la plus belle teinte argentée, et qui avait les proportions et l’aspect d’un grand pic couronné de neige. » — Henry Stanley
Stanley quitta alors Zanzibar en février 1887, accompagné par une grande armée de mercenaires. Lorsqu’il trouva le Pacha aux larges du Lac Albert, fin avril de l’année 1989, l’homme se révéla être un gentleman parfaitement revêtu pour qui l’aide d’un Stanley alors débraillé n’était pas nécessaire. Il fallut une bonne dose d’insistance pour l’amener à mettre les voiles. Stanley raconta la mission dans une œuvre en deux volumes intitulée Dans les ténèbres de l’Afrique. Les détails concernant les événements du 29 mai sont tout spécialement intéressants. « À neuf kilomètres du camp de Nsabé [sur le Lac Albert], comme je me tournais vers le sud-est, méditant sur les événements du mois dernier, un de nos serviteurs attira mes regards vers l’horizon. “Une montagne couverte de sel !” disait-il. Je vis un nuage d’une forme toute particulière, de la plus belle teinte argentée, et qui avait les proportions et l’aspect d’un grand pic couronné de neige. En le suivant de l’œil jusqu’à la base, je fus frappé de sa couleur, d’un bleu intense presque noir, et me demandai si nous étions menacés d’une nouvelle tornade. Puis, comme mon regard descendait vers le fossé ouvert entre les deux plateaux, j’eus tout à coup conscience que ce n’était pas un nuage, une vaine apparence qu’allait dissiper le vent, mais un corps solide et bien réel, une véritable montagne revêtue de neige au sommet. Je donnai ordre de faire halte ; et, prenant ma lunette, je l’examinai avec le plus grand soin. À l’aide d’un compas j’en pris le relevé qui la portait à 215 degrés magnétiques. L’idée me vint alors que ce devait être le Ruwenzori, que deux esclaves de Kavalli m’avaient dit être couvert d’un métal blanc, ou d’une substance ressemblant à de la roche. » Plusieurs choses attirent mon attention dans ce paragraphe. Le 20 avril, un mois avant que Stanley n’assiste au spectacle, deux des membres de l’expédition, T. H Parker et A. J Mountency Jephson, avaient aperçu les montagnes. Comme il l’écrit, il était déjà à la recherche d’une montagne, ou d’une chaine de montagnes, du nom de « Ruwenzori ». Il aurait entendu le nom Rutoro/Runyoro « Rwenjura », signifiant « colline de pluie », et le nom Rukonjo « Rwenzuru », décrivant la même chose, et aurait supposé que la montagne qu’il avait vue était celle à laquelle les natifs faisaient référence. Dorénavant la dénomination acceptée est « Rwenzori », pour se rapprocher le plus possible du nom indigène. Stanley fit le rapprochement entre ces montagnes et les Montagnes de la Lune, parce que sa neige alimentait clairement le Lac Albert. Un an après, Stanley était de retour dans la région. Il envoya W. G Stairs, un des membres de l’expédition, effectuer une courte exploration. Il arriva sur une crête à environ 3 230 mètres, mais ne parvint à aucun sommet. Vient ensuite le problème de la neige. Aucune des langues locales n’avait de mot pour « neige ». Stairs avait toutes les raisons de penser que la cime des montagnes était faite de sel. « Barafu » est le mot pour « neige » en Swahili, la lingua franca. C’est un emprunt à l’arabe qui l’avait à son tour emprunté au mot perse « baraf ». Je gardais un souvenir inéluctable du jour où j’avais entendu ce mot pour la première fois. En 1969, je me retrouvai à la Frontière nord-ouest du Pakistan, en compagnie d’un guide français originaire de Chamonix, Claude Jaccoux, duquel nous reparlerons brièvement, et de sa femme Michèle.
Second voyage
Jaccoux avait repéré une modeste montagne que nous étions censés gravir dans l’Hindou Kouch. Nous nous étions approchés de sa base, depuis notre Land Rover. Jaccoux avait engagé un guide dans le village le plus proche, qui nous conduisit dans la montagne et porta notre tente. À peine étions-nous descendus de la voiture que de gros flocons de neige commencèrent à tomber. « Baraf », avait lancé le guide sur le ton de l’hostilité. Et ce fut la fin de notre ascension.

Le mont Stanley
Crédits
Périple en Équateur
Mon premier réflexe fut de me procurer Guide to the Ruwenzori, de H. A. Osmaston et D. Pasteur. Ce merveilleux livre de poche fut publié en 1972. Il y renferme un bref historique des ascensions du massif ainsi que des descriptions détaillées des nombreuses routes et treks. Rapidement, je trouvai le trek proposé par Jaccoux. Les deux premières phrases semblaient très prometteuses : « Il s’agit d’une route directe et sympathique qui suit principalement les arêtes du massif, évitant ainsi les très fréquents marécages du Ruwenzori, en plus d’offrir de beaux points de vue en altitude. » Les quatre jours qu’il semblait falloir pour parvenir à la base du glacier étaient chacun accompagnés d’une description. Une carte était également disponible, traçant le chemin jusqu’à un certain Moraine Hut, à la base du glacier, à 4 312 mètres. Ce serait mon objectif, avais-je décidé. Juste avant de quitter New York pour Paris, Jaccoux appela pour prévenir qu’il ne pourrait pas mener l’excursion lui-même, mais qu’il envoyait deux guides à sa place. L’un avait vécu et grimpé en Afrique depuis plusieurs années, et l’autre avait effectué ce même trek un an plus tôt. Il expliqua par ailleurs notre programme. Nous prendrions l’avion de Paris jusqu’à Bruxelles, puis de Bruxelles jusqu’à Kigali, au Rwanda. Nous franchirions alors la frontière jusqu’au Zaïre, passerions une nuit à Goma, avant de nous diriger en voiture vers Beni, un trajet périlleux de trois jours, à 386 kilomètres au nord de la ville. Puis, nous parcourrions les 48 kilomètres jusqu’au village de Mutsora, station du Parc national des Virunga située dans le secteur du Ruwenzori. Là-bas nous pourrions obtenir nos permis, des porteurs et un guide local, pour enfin débuter le trek. À l’heure où j’écris cela, je réalise que cette excursion est impossible, maintenant ou à l’avenir. L’intégralité de cette zone est une poudrière pour les conflits armés. En fouillant sur le web à le recherche de voyages au Ruwenzori, je tombai sur plusieurs offres provenant de l’Ouganda mais aucune du Congo. C’est l’une des plus belles régions du monde et elle est perdue. Après un vol interminable en partance de Bruxelles, nous atterrîmes à Kigali. Il pleuvait à notre arrivée, même si nous étions censés être à la saison sèche. Le trajet sur les routes pavées de Giseyni, à la frontière, fut un ravissement, en partie grâce au paysage : des collines ondulées sur lesquelles était bâtie la ville de Kigali. Nous étions le 1er janvier 1990, et j’écrivis naïvement dans mon carnet de bord ce jour-là que « le Rwanda [avait] l’air d’un pays qui fonctionne ». Quatre ans plus tard la seule chose qui fonctionnait était le génocide. Passer la frontière au Zaïre fut un cauchemar. Dans d’autres circonstances la situation aurait pu s’avérer comique. Pour une raison quelconque les gardes-frontière me demandèrent ma taille, que je leur donnai en pieds et en pouces. Ils insistèrent cependant pour qu’elle soit en mètre et centimètres, et décidèrent que je mesurais 1 mètre et 25 centimètres. Je ne contestai pas. Nous devions ensuite transporter notre équipement de l’autre côté de la frontière, où attendait un deuxième bus. Rapidement je fus frappé par le fait que les routes s’étaient dramatiquement détériorées depuis le Zaïre. Alors que nous nous dirigions vers le nord, leur état empirait de plus en plus. Nous passâmes notre première nuit à l’Hôtel Masques de Goma, sur les rives du Lac Kivu. Un autre magnifique endroit qui était perdu. J’eus droit à une surprise à l’hôtel : le propriétaire était un homme dont le visage me disait quelque chose ; pas tout à fait Européen en apparence mais pas non plus Congolais. Il me fut présenté comme étant un physicien. À ma plus grande stupéfaction, il indiqua que son oncle avait remporté un Prix Nobel.

Arrivée
Crédits
Bientôt il n’y aura plus de glace sur l’Équateur. Tout aura fondu.
Le prochain camp s’appelait Muhungu. Il se situait à peine à 3 352 mètres, ce qui voulait dire que nous gagnerions 1 219 mètres d’altitude. La première épreuve qui nous attendait était la descente abrupte du sentier jusqu’à la source du Kanyamwamba. Et quand je dis abrupt, c’est abrupt. Fort heureusement, quelqu’un avait disposé une corde grâce à laquelle l’on pouvait plus ou moins descendre en rappel. L’autre côté du ruisseau était tout aussi incliné, mais un jeu de corde était aussi en place pour que l’on puisse se tirer. Nous arrivâmes sur une arête, elle aussi abrupte, où, après quelques mouvements d’escalade, le groupe se rassembla pour une pause sur un terrain plat. Je devinai que nous avions grimpé environ 300 mètres, ce qui nous en laissait encore 900. Mais gagner de l’altitude n’était rien, si l’on comparait cela au marécage. J’ignorais ce dont parlait le guide britannique, mais c’était un véritable marécage. Une horreur. Chaque pas faisait s’enfoncer votre pied dans un horrible bruit de succion, avant qu’il n’atterrisse sur une pierre visqueuse : un véritable calvaire pour maintenir son équilibre. Alors que j’avançais à tâtons dans le marais, je tombai sur un homme large d’épaule qui s’avéra être un Américain. Il avait fait partie des Corps de la paix, et œuvrait désormais pour une institution chargée de la conservation des sentiers et des camps. C’était à lui que nous devions les cordes que nous avions utilisées plus bas. À notre arrivée au camp, j’étais tellement fatigué que je m’endormis aussitôt. Le jour suivant nous réservait encore des marécages. En trimant pour me frayer un passage, je rencontrai un couple Britannique impeccablement revêtu. Ils m’annoncèrent avec joie qu’il ne restait plus qu’une heure de marais avant que je ne découvre « un peu de plat ». Ce terrain plat s’avéra être le vieux « camp de la bouteille » de Stuhlman. Kyondo, le dernier camp majeur sur la route, se situait seulement 213 mètres plus haut, aussi décidai-je de m’y rendre immédiatement. La vue du pic Marguerite, un des sommets du Mont Stanley, depuis Kyondo, est une des merveilles du Ruwenzori. J’aurais adoré y rester, mais il ne s’agissait pas de la destination finale de la journée. Nous descendions alors pour camper près d’un petit lac – le Lac Gris – duquel les grimpeurs allaient essayer de s’attaquer au glacier le jour suivant. Quant à moi, j’allais me diriger vers Moraine Hut. Il fallut quelques efforts d’escalade pour parvenir jusqu’au lac. Je ne m’étais pas adonné à cette activité depuis un moment, si bien que, même assuré par un de nos guides, je trouvai l’entreprise risquée. Les porteurs utilisèrent un câble fixe. D’en bas, il était facile de marcher jusqu’au lac. Jamais je n’avais vu d’endroit aussi beau. La route est jonchée de lobelias géantes, ainsi que de séneçons, typiques des montagnes équatoriales africaines. Cette étrange végétation démarre à environ 3 962 mètres et se répand sur 300 mètres. Ces plantes énormes ont évolué de façon à s’adapter au climat rencontré dans les hautes altitudes équatoriales. Toutes les 24 heures elles subissent un cycle été/hiver entier. Durant la nuit, l’eau recueillie à l’intérieur se gèle, avant de dégeler au lever du soleil. Lors du cycle de gel, la plante est incapable d’utiliser l’eau qu’elle a emmagasinée, trop visqueuse pour pouvoir circuler. Dans la mesure où les feuilles sont closes pendant la nuit, l’eau ne peut s’échapper. Mais au cours de la journée la plante doit être capable de sécréter. À la lumière du jour, les feuilles s’ouvrent et se referment : il s’agit des formes gigantesques qui permettent aux plantes de se protéger du soleil. Certains des séneçons peuvent grandir jusqu’à atteindre 6 ou 9 mètres. Avant de s’y habituer, cette végétation semble troublante. Nous plantâmes nos tentes près du lac. Les grimpeurs s’apprêtaient à se lever avant l’aube. De mon côté, j’allais attendre que le temps se réchauffe un peu. Par miracle, hormis durant notre premier jour au Rwanda, la pluie ne s’était pas invitée. Le matin suivant fut clair et ensoleillé. Après le départ des grimpeurs, je m’autorisai un petit-déjeuner tranquille, avant de me diriger vers la moraine rocailleuse qui avait l’aspect d’un sentier. D’un côté, les montagnes s’élevaient de toute leur gloire. De l’autre, la verdure du Congo s’étendait dans l’horizon. Je me hissai jusqu’à pouvoir contempler le Moraine Hut. J’étais allé assez loin. J’avais réalisé un rêve d’enfant. Désormais tout a changé. Des randonnées dans les Montagnes de la Lune sont organisées, mais en partance de l’Ouganda. Bientôt il n’y aura plus de glace sur l’Équateur. Tout aura fondu.

Retour au pied des montagnes
Crédits : Jørn Eriksson
Traduit de l’anglais par Mehdi Chauvot. Couverture : , par John Eriksson