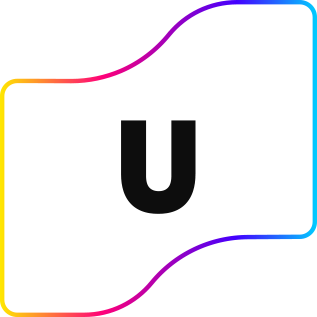Les rues de Lalibela
Ils marchent pour Dieu. Et ils sont des milliers sur les routes en ce mois de janvier, à la veille de Timkat, le jour de l’Épiphanie en Éthiopie. Ils sont chrétiens coptes, et tous marchent vers Lalibela, que l’on dit ici la Jérusalem noire. Certains sont pieds nus, mais leur foi semble les porter. À Lalibela, ils iront se recueillir dans les douze temples creusés à même la roche de cette cité que l’on voulut faire dans le passé à l’image de la ville trois fois sainte d’Israël. À 640 km de routes et de pistes d’Addis-Abeba, la capitale, nous sommes là plus près des cieux qu’ailleurs : 2 700 m d’altitude. L’Éthiopie, c’est le pays des « visages brûlés » – ethiops, en grec. Le pays des mythes de l’Ancien Testament. Un lieu dont nous aurions tous quelque chose en nous, et que les Égyptiens appelaient déjà la Terre des Dieux. L’Église éthiopienne s’affirme aujourd’hui comme la plus orthodoxe, la plus proche des rites originels, ceux des premiers chrétiens. Car elle doit d’avoir conservé ses usages liturgiques les plus anciens, très imprégnés de l’Ancien Testament, au grand isolement dans lequel elle a développé sa spiritualité.

Les pèlerins
Le jour de Timkat
Crédits : Emmanuel Brisson

Une église troglodyte
Les trésors de Lalibela
Crédits : Emmanuel Brisson
Le Tabot Zion
Vais-je donc réellement voir un mythe biblique ? Difficile d’y croire. « Celle que vous allez voir ici est en fait une réplique », m’explique un prêtre, coutumier des questions des touristes. « Tous les temples en ont au moins une. On les appelle des tabots. C’est nécessaire pour être un endroit consacré. La seule vraie Arche, c’est le Tabot Zion. Il est à Axoum. Mais vous ne la verrez jamais, et c’est heureux pour vous ! »
Un prêtre, surtout, amène la foule à l’extase. Il porte au-dessus de sa tête un objet rectangulaire enveloppé dans un brocart bordeaux. C’est le principal tabot de Lalibela.
Mon interlocuteur fait là référence aux pouvoirs grandioses qui sont associés à l’Arche. Ainsi, on ne pourrait la toucher, sous peine d’être foudroyé, et on ne peut même la voir, sans en perdre aussitôt la vue. En Éthiopie, seul un prêtre peut en être le gardien et entrer dans le saint des saints dont il ne ressortira que le jour de sa mort. L’Arche d’alliance est le coffre qui, dans la Bible, contient les tables de la loi, c’est-à-dire les dix commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Le texte sacré en donne une description dans le récit de l’Exode : « …longue de deux coudées et demie, large d’une coudée et demie, haute d’une coudée et demie… » Elle connaîtra diverses pérégrinations, et plusieurs lieux de résidence, avant d’être enfin conduite à Jérusalem par le roi David et placée plus tard dans le premier temple par le roi Salomon. Pour les juifs, les musulmans et les chrétiens, la célèbre relique est portée disparue. Mais pour les Éthiopiens, elle n’a pas disparue. Et ici, on l’affirme bien haut : l’Arche se trouve dans la cité d’Axoum, à l’abri, dans la cathédrale Sainte-Marie-de-Sion. Le lendemain, à peine ai-je mis les pieds hors de mon « hôtel particulier », que je suis pris dans une marée humaine. Difficile de dire en quel temps nous sommes, au milieu de ces prêtres qui psalmodient des prières en suivant le rythme marqué par les sistres. Des files de percussionnistes progressent en une lente reptation au cœur de la foule, partageant leurs prières aux airs joyeux avec tous les participants. Des groupes de jeunes hommes se resserrent parfois, îlots arrêtés sur les flots, pour opérer au son du chant lancé par l’un d’eux quelques pas de danses, comme une ronde, qui les plonge dans un état de transe. Leurs yeux sont brillants, leurs sourires semblent éternels. Les nombreux touristes se sont mêlés à la foule, armés d’un appareil photo. Chaleureusement accueillis dans la procession par les fidèles éthiopiens, ils conservent le sourire amène du voyageur, mais ne semblent pas pris, pour leur part, par la piété du moment. Plus l’heure avance, plus on sent à la ferveur de la foule, toujours plus palpable, que l’événement crucial de la journée approche. Et bientôt, de grands cris de joie s’élèvent. Vêtus d’habits rituels colorés et brodés d’or, les prêtres viennent d’apparaître, sortant de l’ombre de l’une des églises, une grande croix dans la main droite et une crosse dans la gauche. Derrière eux, de jeunes novices les protègent avec des auvents faits de tissus multicolores. Un prêtre, surtout, amène la foule à l’extase. Il porte au-dessus de sa tête un objet rectangulaire enveloppé dans un brocart bordeaux. C’est le principal tabot de Lalibela, une réplique de l’Arche véritable d’Axoum. J’essaye de me faufiler pour m’approcher au plus près du tabot, et en observer les aspects, mais il n’y a pas autre chose à voir que cette forme géométrique drapée. Toutes les autres répliques de l’Arche qui apparaissent à leurs tours sont également couvertes.

Les tabots
Des prêtres portant des répliques de l’Arche
Crédits : Emmanuel Brisson
~
C’est donc Axoum qu’il faut rejoindre, à l’extrême nord du pays, pour tenter de voir ce qui serait la véritable Arche d’Alliance. Cette croyance de l’Église éthiopienne, et les origines qu’elle lui donne, ne trouvent écho nulle part ailleurs, mais l’épopée qui mènera à cet héritage biblique est un récit qui trouve ses fondements dans les temps les plus reculés du judaïsme. Pour en savoir plus sur l’histoire de l’Arche, quelques informations peuvent être trouvées dans les textes sacrés des religions du Livre. En ne prenant que les textes bibliques comme référence, la relique, après avoir été conservée de nombreuses années dans le temple de Salomon, a simplement disparue. Dans la Bible et par déduction des dates, on apprend qu’elle est à Jérusalem vers 955 av. J.-C. (Roi 1 : 27), et c’est la dernière information qui nous est donnée. Même lors de la destruction du temple en 587 av. J.-C. par Nabuchodonosor II, elle n’apparaîtra pas dans le pillage du temple (Roi 7 : 49-50).

Un prêtre
Une halte durant la procession
Crédits : Emmanuel Brisson
Le Kebra Nagast
L’histoire de l’Arche commence il y a près de 3 000 ans, alors qu’elle repose tranquillement dans le temple de Salomon, à Jérusalem. En ce temps-là, la mythique reine de Saba aurait régné sur un grand royaume dont l’Éthiopie et le Yémen se disputent toujours les contours. Ayant entendu parler de ce souverain à qui l’on prête une grande sagesse, la reine, Makéda, part donc pour un long voyage jusqu’en Terre Sainte. Cet épisode est rapporté dans le recueil qui fait le plus foi pour les chrétiens d’Éthiopie, la Bible. Makéda voyage « avec un grand faste, des chameaux chargés d’épices et de beaucoup d’or et de pierres précieuses ». La rencontre apparaît aussi dans le Coran, dans la sourate dite de « La huppe ». Mais un épisode, d’importance pourtant, n’apparaît lui que dans le Kebra Nagast, c’est-à-dire « la Gloire des Rois », une rédaction tardive de la tradition populaire éthiopienne, jusqu’alors orale, qui raconte toute l’histoire royale et religieuse du pays. Il affirme que la rencontre fut féconde et que la reine de Saba donna naissance à un fils, Ménélik.
Cette épopée, digne des grandes aventures que l’on peut lire dans la Bible, est le véritable mythe fondateur de l’Église d’Éthiopie.
À 20 ans, le prince serait revenu faire son éducation à Jérusalem. À partir de là, les histoires varient un peu. Pour certaines, la proximité entre Salomon et son fils n’est pas du goût des pairs du royaume. Leurs pressions sont telles que le roi fini par céder à leurs exigences et accepte de renvoyer Ménélik auprès de sa mère. Mais pour faire pression à son tour, Salomon impose que l’aîné de chaque famille noble accompagne Ménélik. Vengeurs et dépités, les fils d’Israël exilés décident d’emporter secrètement l’Arche d’alliance. D’autres avancent l’hypothèse que c’est Salomon lui-même qui aurait pu confier l’Arche à son fils, afin de soustraire celle-ci des profanateurs éventuels. Des légendes racontent aussi qu’en 650 avant notre ère, le roi Manassé se serait écarté de la foi traditionnelle. Des prêtres auraient alors fui vers le sud, emportant l’Arche, car le roi aurait fait mettre une icône païenne dans le Temple. Cette épopée, digne des grandes aventures que l’on peut lire dans la Bible, est le véritable mythe fondateur de l’Église d’Éthiopie. Un mythe qui proclame ses rois descendants de la plus noble des tribus d’Israël, la lignée de David, celle d’Abraham, Moïse, Jésus, et selon la tradition islamique, de Mohamed. C’est là la fondation de la lignée des rois salomoniens : de Ménélik à Hailé Sélassié, que l’on dit le 225e descendant du roi Salomon. Mais cette lignée n’est pourtant pas ininterrompue, contrairement à l’idée reçue. Ainsi, entre le Xet le XIIIe siècle, le trône d’Éthiopie connaît une autre lignée, jusqu’à la prise de pouvoir d’un nouveau roi qui revendiquera à son tour des origines salomoniennes. C’est pour cela que l’on peut supposer que la rédaction du Kebra Nagast, que l’on situe autour du XVe siècle, avait surtout pour but de légitimer cette nouvelle dynastie. Ce qui rend malheureusement très hypothétique l’ascendance d’Hailé Sélassié, si tant est qu’on admette même la réalité d’un fils du roi Salomon et de la reine de Saba. Ce qu’évoque le Kebra Nagast appartient donc tant à l’histoire qu’à la tradition populaire. Car nulle recherche archéologique n’a pu à ce jour apporter la preuve que la reine de Saba a bien existé. On sait qu’il y eu un royaume de Saba, mais aucune trace, pour l’instant, de Makéda. Des chercheurs disent qu’elle pourrait être une représentation mythologique de plusieurs souverains de Saba. En fait, il n’y a que dans la Bible et le Coran que le nom de Makéda apparaît (Balquis dans le Coran). Mais plus troublant, elle est citée dans les Antiquités judaïques de Flavius Josèphe et serait, selon l’historien juif, une reine d’Égypte et d’Éthiopie (VIII, 6 ; 5, 165).

Ferveur
Des prêtres durant la procession
Crédits : Emmanuel Brisson
~
Comme un autre élément participant aux mythes de la résidence éthiopienne de l’Arche, la présence dans le pays d’une population juive noire, les Falashas, ne connaît toujours pas d’explication définitive. Groupe dissident ayant refusé de suivre Moïse, ou réfugiés de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, leur origine est sujette à caution. Ils seraient en fait, du moins selon la thèse officiellement admise par le grand rabbinat israélien en 1973, les descendants d’une des tribus perdues d’Israël, celle de Dan. Mais pour les Éthiopiens, ils descendraient bien sûr des juifs qui auraient accompagné l’Arche d’Alliance en Éthiopie, au Xe siècle av. J.-C. Depuis le XVe siècle, les Falashas, minorité persécutée, avaient finis par se réfugier dans la région de Gondar, la future capitale des rois éthiopiens à partir du XVIe siècle. Leur nombre a depuis fortement décliné, d’abord en raison des conversions, passant de plus de 500 000 à cette époque à 30 000 au moment des débuts de leur Alya, le retour en Terre Sainte qu’Israël a définitivement clos en 2013. J’ai donc rejoint Gondar. L’endroit, en fait de village véritable, est à l’origine un camp de regroupement dans lequel les Falashas attendaient d’obtenir les autorisations pour pouvoir rejoindre Israël. Mais le temps passant, Waleka a pris ses habitudes de la visite des voyageurs venus voir de près les héritiers d’un mythe, en chair et en os. En Amharique, le mot falasha signifie « exilé », avec un sens un peu péjoratif ; eux-mêmes se nomment plus souvent Beta Israël, la maison d’Israël. Les nombreuses représentations de l’étoile de David que l’on découvre ici montrent combien, au cours des dernières décennies, les Falashas ont travaillé à la reconnaissance de leurs origines. Car il s’agit là d’une réappropriation. Ce symbole pourtant typiquement israélite faisait plutôt partie en Éthiopie des représentations de la religion orthodoxe.

Mareye
Préparation traditionnelle du café éthiopien
Crédits : Emmanuel Brisson

Une tankwa
L’embarcation traditionnelle de la région
Crédits : Emmanuel Brisson
L’Arche
Après une courte traversée, je suis accueilli sur l’île par un prêtre qui m’emmène voir l’endroit où aurait été entreposée l’Arche. « C’est une très ancienne tradition qui raconte que l’Arche a été conservée ici 800 ans », explique le prêtre. « Elle aurait simplement été entreposée à l’air libre, juste sous une tente, dans un lieu appelé Debra Makéda, la montagne de la reine de Saba ». Je trottine derrière l’homme en robe sur un sentier rocheux, entre des buissons épineux, jusqu’à un endroit qui ne diffère en rien, pour moi, du reste du chemin parcouru. « Voici l’endroit où a été installée l’Arche lorsqu’elle est arrivée sur cette île depuis Jérusalem. Et voici les marques des piquets qui supportaient la tente qui l’abritait », dit-il en désignant de petits trous dans la roche sous nos pieds.
« Voici le Kebra Nagast », dit-il doucement, comme si un souffle trop fort pouvait en emporter les épais feuillets.
Il y a autre chose, de bien plus inestimable à mes yeux, que le monastère de l’île conserve. Une véritable relique littéraire : un exemplaire du Kebra Nagast vieux de plusieurs siècles. Le prêtre écarquille un peu les yeux lorsque je formule ma demande, plutôt inhabituelle. Il secoue la tête, arguant de la fragilité du volume. Mais grâce à une bonne dose d’insistance, il accepte enfin que je le suive dans une petite pièce sombre du monastère, juste meublée d’une grande armoire. Depuis le pas de la porte où il m’a enjoint de rester, j’observe le prélat dégager quelques piles de livres avant d’en saisir un, aux allures de vieux grimoires. Lui aussi a conscience de la valeur de l’objet. À pas feutrés maintenant, il s’approche de moi avec son trésor en mains. Pas question bien sûr de le feuilleter moi-même. Ni de prendre une photo. Alors qu’il tourne quelques pages du parchemin, je profite avidement de l’instant, penché au-dessus de son épaule. « Voici le Kebra Nagast », dit-il doucement, comme si un souffle trop fort pouvait en emporter les épais feuillets. « Il raconte l’histoire de l’arrivée de l’Arche depuis Jérusalem en passant par l’Égypte. C’est notre histoire… » Je lui ai alors demandé de me lire ce passage qui décrit l’Arche, et que je sais qu’il contient. Le prêtre a relevé les yeux, fermé doucement l’exemplaire, plissé un peu les paupières, et s’est mis à réciter. Je me suis laissé porter par ce vent d’histoire, pur moment de bonheur, même sans en comprendre un seul mot. En voici la traduction :
Et quant à l’Arche d’alliance… Son existence est pure merveille Elle captive l’œil, frappe l’esprit, Laisse pantois d’admiration. Œuvre toute spirituelle et de compassion, Objet céleste d’une éblouissante lumière, Symbole de liberté et de divinité, sa place Est au ciel et sa mission sur terre.
C’est encore selon le Kebra Nagast qu’en 331, la conversion du Négus Ezana au christianisme entraîne une guerre fratricide entre les premiers tenants de cet héritage spirituel, juif donc, et les récents chrétiens. Et c’est la victoire du Négus qui va leur permettre de récupérer l’Arche d’alliance. Celle-ci va alors connaître son ultime résidence, Axoum. Le nom d’Axoum apparaît pour la première fois au Ier siècle ap. J.-C., dans un traité grec. La ville, dont on pense qu’elle fut créée à la même époque, donnera bientôt son nom au royaume qui s’étendra alors autour d’elle. Obélisques monolithes, stèles gigantesques, tombes royales et vestiges d’anciennes forteresses… Ici, de nombreuses découvertes archéologiques ont été réalisées et attestent en effet de la présence des différentes dynasties préchrétiennes. Les grandes stèles visibles sont parmi les plus grands monolithes jamais façonnés par l’homme. Certaines trouvailles remontent ainsi à trois millénaires, ce qui correspond à la période du règne de la Reine de Saba. Me voici donc plus près que jamais du saint des saints. Dans une ville qui, autrefois, fut interdite d’accès aux non chrétiens. Selon la tradition, Ménélik y serait né. Dans cette cité millénaire, l’Arche d’alliance repose, protégée des regards, dans une chapelle de la cathédrale Sainte-Marie-de-Sion. Un diacre me désigne l’alcôve où elle était conservée dans le passé. Aujourd’hui, on y a placé un tabot encore une fois, mais le plus saint d’entre eux, parce que le plus proche de l’Arche véritable. « Même les prêtres gardiens n’ont jamais posé les yeux sur l’Arche sans la protection des brocarts de velours », m’assure-t-il pour tempérer ma déception. L’ambiance dans laquelle je baigne, ici et maintenant, est empreinte d’une émotion certaine. Je ne sais si c’est la vision de toutes ces personnes recueillies, ou si la proximité de l’objet de mes recherches influence mon ressenti mais, parce qu’une telle conviction, une telle ferveur anime les visiteurs éthiopiens, je ne peux rester insensible au mystère.

La chapelle
Elle abriterait l’Arche d’alliance
Crédits : Emmanuel Brisson
~
Mon nouvel ami dont je tais le nom, à qui je devrais éternellement ce moment d’émotion, me prend par la main et, s’assurant d’abord qu’aucun prêtre n’est témoin de notre circulation, m’emmène au travers des secrets passages des vieilles fortifications qui jouxtent les arrières de la chapelle. Nous arrivons ainsi devant une lourde grille laissant l’espace d’une cour minuscule. Le seul champ extérieur désormais offert au Gardien qui, après que le diacre eu fait tinter les barreaux en les frappant d’un trousseau de clés, apparaît par une lourde porte de bois. Le prêtre, un vieil homme voûté au visage parcheminé, est le casting idéal d’un grand film hollywoodien qui raconterait cette histoire. Lui n’est pas aveugle. Pas encore peut-être. Le diacre introduit ma présence en quelques mots que je ne comprends pas, sans doute un pieux mensonge, que Dieu lui pardonne. Le prêtre demande alors au diacre, qui traduit, si je suis croyant et orthodoxe. Et là, honte sur moi, j’ai menti. Pour toucher de près la vérité des deux hommes. Le prêtre a saisi ma main à travers la grille, et tenant de l’autre un grand crucifix qui pend autour de son cou, a récité une prière. Pour moi et pour tous ceux qui seront en quête un jour. Jamais je ne serai aussi près du mystère. Ni pour le diacre, ni pour le prêtre, il ne fut là question d’argent, de taxe. Un moment de vraie gratuité, de don, auprès de ce qui, pour eux, n’a pas de prix. Je n’en apprendrai, ni n’en verrai plus, pour me faire enfin ma propre opinion sur l’Arche d’Alliance. Le mythe qui perdure en Éthiopie dans une matérialité étonnante n’est pas, à mes yeux, autre chose que la propre vérité de cette Eglise chrétienne d’Afrique de l’Est. En latin, le mot légende signifie « ce qui doit être lu ». L’étymologie donne là une belle démonstration de ce qui doit être compris, à travers les lectures de textes relevant du mythe. Car nul ne peut affirmer ou infirmer l’existence de l’Arche d’Alliance. La chercher est une quête, un chemin vers la connaissance. Ainsi, comme les explorateurs et aventuriers d’antan, les voyageurs d’aujourd’hui peuvent l’entreprendre à leur tour. Car peut-être l’Arche n’est-elle qu’un symbole, une idée, et peu importe sa représentation. Après tout, souvenons-nous qu’en hébreu, elle est appelée Aron ha’Edout, « l’Arche du témoignage ». Et c’est bien ce que font les Chrétiens d’Éthiopie, lorsqu’ils présentent l’Arche d’Alliance en procession. À cette occasion, en effet, ils témoignent de leur héritage unique au monde.

Chrétiens éthiopiens
Un héritage unique
Crédits : Emmanuel Brisson
Couverture : Un monastère éthiopien, par Emmanuel Brisson.