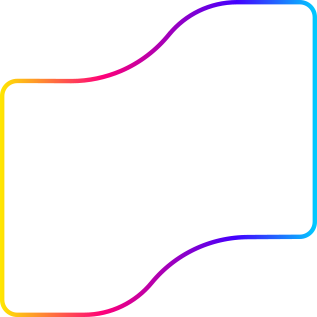Les Vagabonds de Rathkeale
Tard le matin du 5 avril 2011, trois hommes entrèrent dans le bâtiment des sciences du campus de l’université de Coimbra, dans le centre du Portugal. Quand une jeune biologiste arriva pour entamer sa journée de travail, sur le coup de 10 h 30, elle trouva trois hommes répartis sur deux canapés devant la porte verrouillée de son laboratoire, au deuxième étage du bâtiment. À côté d’eux, une autruche empaillée semblait garder l’entrée des lieux. Le plus vieux des trois était un homme roux d’une quarantaine d’années, aux joues rougeâtres, visiblement en surpoids.
Pendant environ une demi-heure, il avait demandé à tous ceux qui passaient devant lui s’ils avaient vu la petite collection d’histoire naturelle derrière la porte. L’homme était doté d’un fort accent irlandais, et son insistance avait quelque chose de suspect. « Il ne cessait de parler de “trophées” », m’a dit Pedro Casaleiro, le conservateur du musée. « Il disait qu’il voulait voir les “trophées”. » L’université de Coimbra, qui fut inaugurée à Lisbonne en 1290 avant de déménager au cours du XVIe siècle dans ce qui est aujourd’hui encore son lieu de résidence , est la plus ancienne université du Portugal, et une des plus vieilles au monde.
À côté, son département des sciences, situé dans un bâtiment néoclassique au sommet d’une colline offrant une vue imprenable sur les toits en terre cuite de Coimbra, fait presque figure de jeune homme. Datant de 1722, il fut construit par un savant italien du nom de Domenico Vandelli, qui posa la première pierre de la faculté des sciences de l’université.

Palais des Écoles
Coimbra, Portugal
Crédits
Vandelli était un naturaliste de renom, un contemporain et un correspondant de Carl Linnaeus, qui donna son nom à une espèce de plante. C’était aussi un fervent collectionneur, et tout au long de sa carrière, il accumula tellement de pièces qu’il en vint à ouvrir un impressionnant musée personnel à Padoue, le genre de lubie très en vogue parmi les intellectuels et les aristocrates d’alors. On y trouvait des pierres provenant de ruines romaines, de la monnaie arrivée de pays lointains, et un automate en argent rapporté d’Allemagne, datant du XVIIe siècle, et capable de lancer des flèches. Il y avait aussi des dizaines d’animaux empaillés, venus des quatre coins du monde.
Après que Vandelli se fut installé à Coimbra, l’université le persuada de venir avec sa collection personnelle. La collection de pièces de taxidermie – qui fut alimentée, les siècles suivant, par des spécimens venus des colonies lusitaniennes – occupe aujourd’hui une large partie du second étage du bâtiment des sciences. Arrangées en forme de « L », ces pièces se trouvent au sommet d’un imposant escalier de calcaire. Cette collection d’histoire naturelle n’était accessible que sur rendez-vous, et nos trois intrus n’en avaient pas pris ; le réceptionniste du musée des sciences de l’université leur avait déjà refusé l’accès peu de temps avant leur incursion cavalière. Mais ce matin-là, la biologiste se voulut charitable, et elle proposa aux trois visiteurs de jeter un coup d’œil rapide à l’intérieur.
Elle déverrouilla la porte et les fit traverser plusieurs pièces sombres, tâtonnant à la recherche d’un interrupteur. L’homme roux restait proche d’elle, si proche que la biologiste s’en agaça. Les deux autres traînassaient derrière, immortalisant l’instant avec leurs téléphones portables. Après plusieurs minutes, ils parvinrent à la pièce qui contenait une large partie de la collection de Vandelli. Avec son carrelage froid, ses rideaux rouges et ses boiseries, l’endroit dégageait l’atmosphère compassée et mystérieuse d’un siècle révolu. Les seuls concessions faites à la modernité étaient les installations lumineuses et, nichée dans un coin, une caméra de surveillance. Un squelette humain et un paon faisant la roue étaient posés contre un mur.
À leurs côtés se trouvait un lion qui avait dû être empaillé par un taxidermiste peu sûr de son anatomie ; la gueule du félin semblait plate et large, barrée d’un petit sourire, comme si le tout n’était qu’un masque porté par un humain. Sur le mur opposé, plusieurs cabinets de bois contenaient des oiseaux tropicaux, des petits primates, et des rongeurs plus habitués à la jungle qu’au velours d’un meuble figé. Les gardiens de ce curieux endroit, postés de chaque côté du seuil de l’entrée, étaient deux lamantins empaillés, dont la peau huileuse avait tant vieilli qu’elle semblait noire.
Quand la police revisionna les bandes, ils découvrirent que les voleurs avaient commis une erreur.
La visite touchant à sa fin, l’homme au visage rougeâtre – le seul parmi les trois visiteurs à avoir parlé ce jour-là – posa à la biologiste une curieuse question : l’université prêtait-elle des pièces de sa collection de taxidermie les weekends ? Elle répondit que non, ce qui ne sembla pas contrarier son interlocuteur ; il lui dit qu’ils avaient tous trois passé un agréable moment et amèneraient probablement leurs familles respectives pour une visite dans le mois. Seize jours plus tard, une autre employée de l’université marchait au milieu de la collection Vandelli quand elle remarqua quelque chose d’inhabituel. À y regarder de plus près, elle vit que l’une des portes d’un des cabinets de bois était entrouverte.
À l’intérieur, tout semblait normal, à une exception près : une paire de cornes de rhinocéros avait disparu. « Ils n’ont rien endommagé », m’assura Casaleiro, pointant le cabinet où les cornes se trouvaient. « Ils n’ont même pas brisé la vitre. » C’était un mardi après-midi du mois de novembre 2013, et Casaleiro – un homme bien charpenté d’une quarantaine d’années, les cheveux bruns tirant vers le gris aux tempes et la pose assurée d’un étudiant de second cycle – avait accepté de me montrer le lieu du vol. Après que les cornes furent portées disparues, il m’apprit que son premier réflexe avait été de vérifier les vidéos de surveillance. « On avait des caméras dans chaque pièce », dit-il.
En visionnant les bandes datant du mardi précédent, autour de cinq heures de l’après-midi, il vit deux silhouettes, les coupables, entrer par l’aile ouest du bâtiment. Ceux-ci avancèrent rapidement vers la pièce où se trouvait l’essentiel de la collection de Vandelli, marchèrent vers le cabinet contenant les cornes de rhinocéros, et en crochetèrent délicatement la porte. L’un des hommes se saisit des cornes et les mit à l’intérieur d’un sac à dos. Ce dernier s’avérant trop petit, ils retirèrent leurs vestes et enroulèrent les cornes à l’intérieur, prirent leur butin sous le bras et quittèrent les lieux, s’éloignant du bâtiment dans la lumière déclinante d’une fin d’après-midi d’automne.
Les vidéos ne révélèrent guère plus que le déroulement des événements. Les images étaient de mauvaise qualité et baignaient dans un noir et blanc granuleux, celui que proposent généralement les caméras infrarouge disposées dans une pièce sombre. « Les voleurs portaient des chapeaux comme ça », dit Casaleiro, mimant avec son bras une étoffe qui lui tombait jusque sous les yeux, « pour que nous ne voyions pas leurs visages. » Mais quand la police judiciaire – l’autorité qui enquête sur les crimes graves au Portugal – revisionna les bandes, ils découvrirent que les voleurs, bien que veillant à parfaitement dissimuler leurs traits, avaient commis une erreur. Pendant le braquage, l’un d’eux avait sorti un téléphone portable.
En passant au peigne fin le trafic téléphonique de l’après-midi, les enquêteurs furent capable de retrouver l’unique coup de téléphone passé depuis l’intérieur du musée. L’indicatif-pays du destinataire de l’appel était le 353, et l’indicatif téléphonique le 086 – le numéro était irlandais. Son propriétaire vivait dans une petite ville du nom de Rathkeale.

La rivière Deel
Rathkeale, Irlande
Crédits : Charles Homans
Rathkeale se trouve à 30 kilomètres au sud-ouest de Limerick, la plus grande ville de la région du midwest irlandais, situé au milieu de pâturages quadrillés par des clôtures en bois couvertes d’orties. Autrefois ville marchande animée, Rathkeale compte aujourd’hui environ 1 500 habitants permanents. L’endroit est plutôt agréable, mais à l’instar des villages agricoles des coins les plus désertiques du centre des États-Unis, il donne l’impression d’avoir été figé au milieu du siècle dernier. Il y a une rue principale avec quelques pubs, un guichet pour parieurs, et un cinéma fermé doté d’une façade en béton poli.
Un panneau peint à la main nous renseigne sur l’existence d’un club de boxe local. Trônant devant une boutique de vêtements pour femme, une sculpture en céramique grandeur nature de Marylin Monroe accueille les clientes. La plupart des gens sont plus vieux que la moyenne ; la plupart des locaux sont vides. Il est tentant de dire que Rathkeale est le dernier endroit où l’on pensait trouver les principaux responsables d’une vague de crimes qui, à la fin de l’année 2013, avait provoqué la disparition d’une centaine de cornes de rhinocéros de musées, de maisons de vente et de collections privées dans seize pays européens. Mais il est également difficile d’imaginer qu’on ait pu faire un jour ce constat. Les vols, dans le monde des musées d’histoire naturelle, sont extrêmement rares.
Que les enquêteurs aient pu croire qu’ils étaient l’oeuvre de plusieurs dizaines de criminels basés dans un village reculé de l’Irlande était peut-être moins surprenant que le simple fait qu’ils aient eu lieu. Les crimes avaient commencé bien avant 2013, avec une série d’incidents qui poussèrent les policiers à se poser des questions : des taxidermistes et des antiquaires déclarèrent avoir reçu des coups de téléphone de la part d’hommes au fort accent irlandais, leur demandant s’ils vendaient des cornes de rhinocéros, et faisant preuve de candeur lorsque leurs interlocuteurs leur exposaient les restrictions juridiques quant au commerce de telles pièces.
Puis les vols commencèrent. Un par mois, au début, mais à leur apogée, peu de temps après le vol de Coimbra, les autorités en comptaient un tous les deux jours. Parfois, comme à Coimbra, les voleurs étaient plutôt talentueux, ne provoquant aucun dégât, mis à part les quelques égratignures qu’on pouvait trouver dans l’embrasure des portes des cabinets qu’ils allégeaient de leur contenu. Dans d’autres cas, ils étaient brouillons, comme ceux qui aspergèrent les gardes d’un musée parisien avec du gaz lacrymogène, s’échappant des lieux avec une corne de rhinocéros blanc à 14h, un dimanche après-midi.
Et quand les malfaiteurs étaient arrêtés, les cornes demeuraient introuvables, ce qui ne surprenait personne ; tout le monde pensait qu’elles étaient rapidement réduites en poudre et envoyées en Chine, où la croyance populaire prête aux cornes de rhinocéros un grand pouvoir médicinal et où elles se marchandent aux alentours de 65 000 dollars le kilo (à titre de comparaison, aux États-Unis, la cocaïne vaut 25 000 dollars le kilo). Une estimation raisonnable de la valeur de la totalité des cornes manquantes atteindrait facilement plusieurs dizaines de millions de dollars.

Les cornes d’un rhinocéros mâle
Zoo de Zurich
Crédits
Les épidémies criminelles se nourrissent parfois de l’euphorie de leur propre bizarrerie, les casses les plus insolites faisant la une des quotidiens et inspirant des copieurs parfois bien moins experts. Il est probable que certains des vols de cornes furent l’œuvre d’imitateurs, comme celui de Colchester, en Angleterre, au cours duquel un individu parvint à subtiliser la tête d’un rhinocéros mort depuis peu dans un zoo local ; plus tard, un antiquaire fut appréhendé alors qu’il était sur le point d’embarquer dans un avion, des cornes de rhinocéros dissimulées dans un faux oiseau de bronze viennois.
La théorie des copieurs aurait pu expliquer l’un des aspects les plus étonnants des vols de cornes de rhinocéros, à savoir l’ubiquité et l’omniscience apparentes des criminels. Ils volaient les cornes dans des musées connus, mais aussi dans des établissements plus discrets et moins urbains, où peu de gens, en dehors de leurs propriétaires, auraient pu se douter qu’on y trouvait des cornes de rhinocéros.
Mais la relative uniformité des tactiques des voleurs, tout comme les traces que laissaient les différents SMS et coups de fil émis pendant ou peu après leurs méfaits, conduisirent les autorités à déduire que la grande majorité des vols était commis par un seul et même réseau – un réseau informel et peu organisé, composé d’une demi-douzaine de familles qui opéraient chacune avec plus ou moins d’autonomie, mais avaient toutes des liens au sein de la même communauté. Les médias et la police irlandaises les surnommèrent les Vagabonds de Rathkeale.
« Mon intuition est que la plupart des vols avaient un lien avec les Vagabonds de Rathkeale », me confie John Reid, un analyste travaillant pour l’agence de police internationale Interpol qui passa des années à étudier le groupe. « Mais ce n’est pas quelque chose que je peux prouver. » Rien qu’en 2013, les enquêteurs retrouvèrent la trace des Vagabonds de Rathkeale jusqu’en Russie et en République Dominicaine, mais aussi au Canada et en Argentine, sans oublier l’Australie et la Nouvelle-Zélande. « Ils sont présents sur tous les continents, sauf en Antarctique – du moins, pas à ma connaissance », me dit Andy Cortez, un agent spécial qui travaille pour le service américain de la protection de la faune et de la flore, et qui enquêta sur les activités américaines des Vagabonds.
Les vols instaurèrent un climat de panique au sein des musées d’histoire naturelle, surpris par cet assaut sans précédent sur des lieux qui, si l’on raisonne en terme d’activité criminelle, étaient ceux que attiraient le moins l’attention. « Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu quelque chose de similaire – en tout cas, pas de manière si coordonnée », m’avoue Paolo Viscardi, conservateur au Horninam, le Musée d’Histoire Naturelle de Londres. Alors que le modus operandi des criminels prenait forme aux yeux des enquêteurs, les musées commencèrent à retirer leurs spécimens de rhinocéros de leurs expositions, ou remplacèrent leurs cornes par des répliques en plastique. La technique porta ses fruits : à la mi-2012, le nombre de vols avait considérablement baissé.
Puis, à 10 h 40, le 17 avril 2013, trois hommes masqués pénétrèrent à l’intérieur d’un vaste entrepôt à Swords, dans la banlieue nord de Dublin. Cette ancienne usine Motorola grande comme deux terrains de football était située dans une vaste zone industrielle non loin de l’aéroport de Dublin. Elle appartenait au Musée National d’Irlande, qui abritait la plupart de la collection non exposée. Parmi les objets qu’on pouvait y trouver figuraient quatre têtes de rhinocéros, retirées de l’aile du musée consacrée à l’histoire naturelle au pic des activités des Vagabonds de Rathkeale. Les cambrioleurs ligotèrent l’unique gardien et fouillèrent longuement les lieux (« Vous avez déjà vu Les Aventuriers de l’Arche Perdue ? » m’a demandé Nigel Monagham, le conservateur du Musée d’Histoire Naturelle. « Trouver l’Arche d’alliance, cela prendrait du temps… »).
Après une heure de recherche, ils trouvèrent les têtes de rhinocéros cachées derrière une bâche. Le temps que le gardien se libère de ses liens, ils avaient déjà transporté leur butin sur de lourds chariots, l’avaient chargé à l’arrière de leur van et avaient disparu dans la nuit. Non sans affection, les Dublinois surnomment leur musée d’histoire naturelle le Zoo Mort, et le sobriquet inspira les journalistes qui travaillaient pour le tabloïd Sunday World, qui avait dédié aux Vagabonds bien plus d’encre que ses concurrents. Ils décidèrent d’affubler les voleurs d’un nouveau nom de scène. Ils les appelèrent le Gang du Zoo Mort.
La corne du rhino
« La grande tragédie du rhinocéros, observait l’écologiste Lee M. Talbot en 1959, est qu’il transporte une fortune sur son nez. » Cette affirmation se vérifie depuis des siècles, tant le rhinocéros est une proie convoitée tant par les Asiatiques que par les Européens. Les Grecs et les Romains croyaient que la corne du rhinocéros d’Inde était un anti-poison. Les apothicaires européens en vendirent tout au long du Moyen-Âge ; elle était considérée comme un substitut pharmacologique tout à fait capable de remplacer l’appendice de la licorne, et était, fatalement, plus facile à trouver.

Le rhinocéros
Gravure d’Albrecht Dürer
1515
Mais c’est dans l’Empire du Milieu que l’appétit pour la corne de rhinocéros demeure le plus vorace. Son usage thérapeutique, en Chine et chez ses voisins, date au moins de l’Âge de Bronze. Un materia media chinois du IVe siècle lista la corne comme un antidote capable de soigner les morsures de serpent et d’exorciser les patients possédés par le démon (contrairement à la croyance populaire d’autres contrées, aucun document historique n’indique que les Chinois utilisaient la corne de rhinocéros comme aphrodisiaque ; c’est un mythe inventé par des Occidentaux bien mal informés). Des gobelets sculptés dans la corne, connus sous le noms de coupe de libation, étaient sensés transmettre un pouvoir de vie au liquide qu’on versait à l’intérieur.
Jusqu’au XVIIe siècle, la Chine avait ses propres rhinocéros. Aujourd’hui, on trouve la plus grande population de ces animaux en Afrique, et seulement quelques survivants en Asie du Sud et du Sud-Est. La plupart des rhinocéros asiatiques ne possèdent qu’une seule corne. Les rhinocéros blancs et noirs d’Afrique, ainsi que le rhinocéros de Sumatra, en ont une paire : une corne postérieure qui prend souvent la forme d’une dent de requin atrophiée, et une corne antérieure, plus grande, qui, chez les rhinocéros africains, peut se mesurer en décimètres. La corne du rhinocéros n’est, à proprement parler, pas une corne – à l’inverse de celles des buffles et des antilopes, qui ne sont qu’une extension de leur crâne et sont composées entièrement d’os. La corne du rhinocéros est faite de kératine, la même fibre protéinée que l’on trouve dans les ongles et les cheveux, comprimée à l’intérieur d’un matériau à la densité et à la texture semblable à celle de l’acajou.
Coupée, elle repousse, suivant un parcours logarithmique qui rappelle l’élégance fractale et l’exactitude mathématique que l’on retrouve dans la spirale d’un coquillage et le tourbillon que dessine le faucon en fondant lentement sur ses proies, mouvement qu’imitent les pluies saillantes qui accompagnent les ouragans. Un médecin moderne contesterait l’existence des propriétés pharmacologiques de la kératine et expliquerait que, dans tous les cas, absorber de la poudre de corne de rhinocéros à 65 000 dollars le kilo ou celle de vos propres ongles est une expérience équivalente. Ceux qui veillent à la sauvegarde des espèces en danger l’expliquent depuis des années, sans que cela ait un quelconque impact sur l’extinction du rhinocéros.
La seconde tragédie de l’animal est que, malgré son aspect menaçant, il est une proie facile. Pataud, myope et désespérément curieux, c’est un trophée tout trouvé pour les chasseurs qui ont su adapter leur arsenal à sa peau épaisse et dure. « Il m’est impossible de croire que les rhinocéros puissent survivre longtemps, observa Theodore Roosevelt après en avoir tué treize, excepté dans des endroits isolés ou des réserves qui leur seraient dédiées. » Les naturalistes et les chasseurs d’autrefois voyaient dans le rhinocéros un anachronisme exotique, un fugitif de la Préhistoire vivotant dans un monde pour lequel il n’était pas du tout adapté.
Pour Theodore Roosevelt, un rhinocéros noir croisé lors d’une partie de chasse dans le Congo Belge en 1909 n’était rien d’autre qu’un « monstre, une relique du passé du monde, venu des jours où les bêtes se repaissaient de leur propre puissance, avant que l’homme ne conquît son cerveau et ses mains afin de les mettre au pas ». Dans les années 1970, le rhinocéros se retrouva dans un monde encore un peu plus inhospitalier. L’Asie orientale se modernisait à grande vitesse, tandis que les pays subsahariens où habitaient les rhinocéros gagnaient leur indépendance tout en sombrant dans l’anarchie, la pauvreté et la guerre civile. Les contrebandiers armés décimaient encore un peu plus les populations qui avaient survécu à l’époque romantique des chasseurs blancs.
Chaque année, les commissaires priseurs voyaient passer dans leurs salles de vente près de 3 400 kilogrammes de cornes de rhinocéros – provenant de 1 180 animaux – vendus en Chine, à Taiwan, en Corée du Sud, au Japon, et particulièrement à Hong Kong.

Trois rhinocéros abattus par Theodore Roosevelt
Muséum national d’histoire naturelle de Washington, 1959
Crédits : Smithsonian Institution Archives
Hong Kong mit fin à l’importation de cornes en 1979, et la plupart des pays importateurs suivirent cet exemple. Certaines autorités de la médecine traditionnelle chinoise aidèrent également à promouvoir l’utilisation de la corne de buffle d’eau en lieu et place de celle du rhinocéros. Bien que l’appétit de l’Asie orientale pour la corne ne s’estompât pas véritablement, au début du XXIe siècle, les populations de rhinocéros s’étaient relativement étoffées par rapport à leur nadir, atteint dans les années 1970 et 1980, et les efforts de sauvegarde de l’espèce pouvaient être considérés comme un relatif succès.
Une étude datée de décembre 2007 menée dans treize pays d’Afrique montra que, à l’exception de deux cas, le nombre de rhinocéros blancs et noirs était stable, voire en augmentation. Selon les chiffres, les braconniers dans les parcs nationaux d’Afrique du Sud – où il reste le plus de rhinocéros au monde – massacraient deux douzaines d’animaux par an. L’enchaînement d’événements qui conduit à de nouvelles tragédies pour les populations de rhinocéros dans le monde n’est pas très clair, mais son épicentre semble se trouver au Vietnam, au début des années 2000.
L’histoire la plus courante est celle d’un officiel vietnamien atteint d’un cancer, qui saupoudra son breuvage d’un peu de poudre de corne et clama plus tard être entièrement guéri, faisant de la corne de rhinocéros un phénomène national. On ne connait toujours pas le nom de cet officiel, ce qui alimente la théorie que cette histoire est non seulement scientifiquement douteuse mais aussi sans fondement, ou du moins bien trop éloignée de sa version d’origine pour avoir une quelconque crédibilité factuelle. Certains conservateurs pensent qu’elle fut inventée de toute pièce par des braconniers pour accroître la demande de leur produit.
L’histoire la plus plausible est qu’il y a environ une dizaine d’années, la croissance économique vietnamienne s’est considérablement accélérée, provoquant ainsi l’émergence d’une élite argentée et d’une classe d’entrepreneurs aisés, certains s’installant jusqu’en Afrique. La confluence de ces deux tendances raviva la demande pour la corne. Rapidement, elle fut vue comme capable de guérir n’importe quel mal, même ceux pour lesquels elle ne fut jamais utilisée médicalement. Certains praticiens au Vietnam en prescrivirent à leurs patients sous forme de pilules. La corne devenant de plus en plus chère, l’élite vietnamienne voulut en posséder davantage ; des sites vantaient du vin à la poudre de corne, « la boisson alcoolisée des millionnaires » – une forme de consommation qui flattait avant tout le client.
En même temps, la demande pour la corne augmenta en Chine, où certains activistes prétendent que les contrebandiers y font à nouveau des coupes de libation et des bijoux. La chasse sportive de rhinocéros est autorisée en Afrique du Sud, mais son coût et l’impopularité de ce type d’activité parmi la population locale ont drastiquement diminué le nombre de personnes enclines à pratiquer cette activité, et ce sont souvent des Européens ou des Américains qui s’adonnent à ce sport. En 2004, pourtant, les personnes en charge d’encadrer cette chasse peu commune virent une recrudescence du nombre de chasseurs vietnamiens venus s’attaquer au rhinocéros – le Vietnam n’est pas un pays connu pour pratiquer la chasse de gros gibier.
Il était inévitable qu’un jour, quelqu’un se posât la question suivante : Est-il possible de mettre la main sur des cornes de rhinocéros sans avoir à tuer l’animal ?
En 2009, il y avait trois fois plus de chasseurs vietnamiens en Afrique du Sud que de toutes les autres nationalités réunies. Certains témoignages rapportèrent que des Vietnamiens étaient mêmes prêts à payer des sommes astronomiques, bien supérieures à celle réclamées par les organisateurs de ce genre d’événements, pour chasser le rhinocéros, mais ne savaient pas tenir un fusil ; après une chasse heureuse, ils demandaient de l’aide pour retirer les cornes de l’animal, mais n’exprimaient aucun intérêt pour le reste du cadavre. La pratique fut désignée sous le terme de pseudo-chasse ; bientôt, des touristes chinois, thaïs et cambodgiens vinrent aussi pratiquer la pseudo-chasse. Le gouvernement sud-africain commença à limiter l’exportation de trophées faits à base de corne de rhinocéros, mais cela ne fit que repousser le problème.
En 2007, 13 rhinocéros furent braconnés dans les parcs nationaux d’Afrique du Sud. En 2008, il y en eut 83. L’année suivante, on déplora 122 victimes. 333 en 2010. 448 en 2011. Le braconnage atteignit un niveau de perfectionnement et d’efficacité que les gardes forestiers n’avaient jamais vu ; les habitants du coin aux Kalashnikov de fortune avaient été remplacés par des professionnels embarquant à bord d’hélicoptères non immatriculés, armés de fusils à lunette et, occasionnellement, d’arbalètes. Certains utilisaient des fléchettes tranquillisantes, chargées de drogues paralysantes, uniquement accessibles aux vétérinaires en temps normal. Ailleurs, les rhinocéros qui restaient devaient affronter un ennemi plus terrible encore.
En 2008, au Zimbabwe, quatre fois plus d’animaux avaient été braconnés par rapport à l’année précédente. Le rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest, qu’on rencontrait autrefois du Cameroun jusqu’au Soudan, fut classé « éteint » trois ans plus tard. En avril 2010, les membres d’une ONG étudiant le parc national du Cat Tien, au Vietnam, retrouvèrent la carcasse d’un rhinocéros vietnamien de Java, une espèce moins connue – c’était le dernier rhinocéros sauvage du Vietnam. L’animal avait un impact de balle dans une patte, et sa corne avait été sciée.
Chasser une espèce s’approchant lentement de son seuil d’extinction n’est pas un business d’avenir. Ainsi, il était inévitable qu’un jour, quelqu’un, quelque part, se posât la question suivante : Est-il possible de mettre la main sur des cornes de rhinocéros sans avoir à tuer l’animal ?
Un marché de dupes
En 2010, l’inspecteur de police britannique Nevin Hunter travaillait au port de Bristol, côté ouest. Il était en mission pour une agence gouvernementale responsable de la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Lors de sa signature en 1973, l’accord visait à limiter le commerce trans-frontalier d’objets et d’artefacts issus d’espèces en voie d’extinction et exigeait que chacun des pays signataires veillât à surveiller et sanctionner la contrebande.
Cet été-là, un analyste alerta Hunter au sujet d’une nouvelle pratique. Plus tôt dans l’année, le bureau avait reçu un nombre inhabituel de demandes de permis d’exportation de cornes de rhinocéros. Le chiffre n’était pas exceptionnel, peut-être pas plus d’une vingtaine sur une année, mais c’était bien plus que la normale – on avait rempli guère plus de deux ou trois demandes au cours des périodes précédentes. Quasiment à chaque fois, le port de destination de la corne était la Chine ou Hong Kong. Les cornes provenaient souvent de salles de vente anglaises – le bon endroit, sans doute le meilleur, pour trouver des animaux africains empaillés à bas coût.
Au temps de l’Empire britannique, les aventuriers, les chasseurs et les colons remplissaient leurs maisons anglaises de têtes, de peaux et de cornes d’animaux sauvages, la plupart terminant leur route entre les mains de leurs héritiers, qui les considéraient avant tout comme d’encombrants vestiges dont il fallait se débarrasser. Ce qui conduisit ces objets à passer d’antiquaires à antiquaires. Mais à l’inverse des trophées de rhinocéros ou d’éléphant tués dans un passé plus récent, leur commerce était considéré comme légal.

Un moine népalais
Samye, au Tibet, 1935
Crédits : Ernst Schäfer
Il était cependant étrange que des particuliers ou des professionnels s’intéressassent soudain à ces objets ; et plus encore que l’engouement soudain pour ces reliques allasse de pair avec l’explosion du braconnage dans le monde. L’inspecteur Hunter dispatcha ses enquêteurs dans de nombreuses salles de vente pour comprendre ce qu’il s’y tramait.
La donnée la plus spectaculaire qu’il recueillit fut celle obtenue lors d’une vente dans le Yorkshire, en août 2010, où trois cornes d’origine très proche – elles avaient toutes été prélevées sur des rhinocéros noirs abattus dans les années 1880 – furent vendues pour les sommes pharaoniques de 30 000, 57 000 et 61 000 livres sterling. Seule leur taille respective justifiait un tel écart de prix. « Les cornes n’ont pas été vendues selon leur origine ou leur provenance, elles ont été évaluées par rapport à leur poids », m’expliqua Hunter, aujourd’hui directeur de la brigade nationale de la répression des atteintes à la vie sauvage en Grande-Bretagne.
La conclusion était claire : « En s’offrant ces cornes, les gens n’achetaient pas des antiquités. » Un cadre travaillant dans une salle des ventes britannique m’avoua un jour avoir remarqué la même chose dans son établissement, et cela commença au cours de l’année 2009. Il n’y avait aucun doute sur le fait que les cornes « étaient ensuite ramenées en Chine par des moyens illicites, via Hong Kong, où les contrôles aux frontières sont très laxistes, ou alors dissimulées dans les bagages de passagers à priori lambda. Les prix étaient hors du commun, et ils ne cessaient d’augmenter. J’ai un jour demandé à un acheteur ce qu’il comptait faire de ses cornes ; il m’a dit vouloir les sculpter. C’est un marché de dupes… »
Lorsqu’ils assistaient à des ventes aux enchères, Hunter et ses enquêteurs étaient à chaque fois surpris de découvrir que les clients chinois n’étaient pas les seuls étrangers présents dans la salle. À leur côté, et souvent en discussion avec eux, on trouvait des Irlandais. Hunter commença à s’intéresser à ces derniers, et à récolter leurs noms. Il se rendit compte que les mêmes acheteurs se donnaient rendez-vous dans d’autres salles des ventes à travers le Royaume-Uni. J’ai récemment demandé à Hunter si certains des noms qu’il avait relevés à l’époque figuraient dans la liste des personnes interrogées à propos des vols de cornes de rhinocéros dans le cadre de l’affaire des Vagabonds.
« Il serait idiot de répondre par la négative, me répondit-il. En fait, voilà comment se présentent les choses… » La demande pour les cornes de rhinocéros augmentait avec les prix. « Les Irlandais étaient tout à fait enclins à les acheter et partout où ils passaient, ils demandaient si des cornes allaient être mises en vente, me confia le cadre de la salle des ventes. Mais dès que la vente devenait publique, quelqu’un surenchérissait et les cornes leur passaient sous le nez. » Mais il existait des cornes de rhinocéros là où des acheteurs chinois ne se rendraient jamais.
Le 26 juillet 2010, un taxidermiste dénommé James Marsico décrocha le téléphone de son domicile à Cody, dans le Wyoming. Son interlocuteur se présenta comme un Irlandais vivant au Brésil et dit à Marsico qu’il faisait des affaires sur le marché des trophées africains – notamment des trophées de rhinocéros. « J’ai beaucoup d’argent, précisa-t-il à Marsico. Et je paie cash. » Marsico raccrocha.
Cet après-midi là, il se rendit sur taxidermy.net, un forum en ligne qu’il avait l’habitude de fréquenter, et rédigea une note décrivant son étrange coup de fil. Le titre de son post était « Acheteur dans la nature dont il faut se méfier ». Au début, les commentaires étaient moqueurs. « Voyons, Jimmy, lui répondit un membre du forum, ce n’est juste pas un chasseur. » Mais d’autres trouvèrent l’histoire de Jimmy bien familière :
« Je recherche de vraies cornes, lui répondit Sullivan. Si vous avez une piste, tenez-moi au courant. »
« Il se passe des choses bizarres autour du rhinocéros… Ils discutent avec toi, se renseignent sur ce que tu as, organise un rendez-vous et c’est un de leurs partenaires qui vient pour voir la marchandise… Et le lendemain, tu te rends compte que tu t’es fait cambrioler. » « Ma femme a reçu un appel de ce genre hier. Elle pensait que c’était moi qui lui faisais une blague. » Un taxidermiste résidant en Floride s’immisça dans le fil de discussion. « J’ai reçu un e-mail aujourd’hui, j’imagine que c’est le même mec ! »
L’e-mail en question provenait d’un certain John Sullivan, dont l’orthographe et la ponctuation laissaient à désirer. Sullivan écrivait qu’il voulait égayer l’entrée de son hôtel dans le comté de Kerry, en Irlande, avec des trophées d’animaux africains. « J’ai de grandes difficultés pour trouver une tête de rhino ou une corne en Irlande. » Il précisa vouloir une vraie corne – « pas une reproduction en fibre de verre ». Sullivan avait envoyé des e-mails du même ordre à d’autres utilisateurs de taxidermy.net, bien que la plupart d’entre eux eussent effacé ou ignoré ses relances. Mais un homme, un chasseur de gros gibier résidant dans le Colorado, lui répondit.
Il assura à Sullivan pouvoir obtenir des imitations de cornes de rhinocéros – assez bien reproduites pour passer pour des vraies. « Je recherche de vraies cornes, lui répondit Sullivan. Si vous avez une piste, tenez-moi au courant. » Le chasseur dit à Sullivan qu’il avait un ami du nom de Curtis Phillips, et qu’il avait probablement quelque chose qui intéresserait Sullivan.
~
L’après-midi du 13 novembre 2010, une Jeep se gara devant une petite maison aux briques jaunes de Commerce City, dans l’État du Colorado, une banlieue miteuse où pullulaient motels et relais routiers, au nord-est de Denver. Deux jeunes hommes sortirent du véhicule et sonnèrent à la porte, puis entrèrent dans la maison sans plus de formalité. Deux hommes plus âgés les attendaient à l’intérieur.
« — Bien, dit Curtis Phillips. Vous avez beaucoup voyagé, n’est-ce pas ?
— Ah, les voyages, soupira l’un des visiteurs, qui se faisait appeler Mike.
— Ça va ?
— On fait aller. »
La maison appartenait au chasseur, bien que lui-même et la maison avaient connu des jours meilleurs. Curtis, assis sur une chaise à bascule près d’un bureau, toussait sans arrêt, trahissant son état de santé qui allait en se dégradant. Le salon ne semblait pas avoir reçu la visite d’un aspirateur depuis de longues années. Deux têtes de cerfs et une petite ménagerie de faune et de flore africaines pendaient aux murs. Les visiteurs prirent place sur le canapé. Ils étaient beaux-frères et venaient d’Irlande.
Mike et Richard – là encore, c’est le seul nom que ce dernier donna – ne se ressemblaient pas. Mike était grand et devait approcher de la quarantaine ; Richard devait avoir une vingtaine d’années, il était plus petit et plus empâté. Quand les quatre hommes s’étaient rencontrés pour la première fois, Richard s’était présenté comme étant le cousin de John Sullivan. Mike et lui étaient venus rencontrer Phillips au sujet de plusieurs cornes de rhinocéros qu’un des parents du chasseur essayait de vendre. « Vous avez déjà réussi à sortir des cornes de rhinocéros des États-Unis sans vous faire prendre ? demanda Phillips. Que je sois sûr de cela. »
Le commerce international de trophées de rhinocéros était tout de même strictement interdit par la loi américaine, sauf si le commerçant possédait un permis spécial, qu’évidemment Phillips n’avait pas. « Si vous nous livrez la marchandise, on trouvera un moyen », lui dit Mike. Richard expliqua que Mike et lui étaient antiquaires ; il serait aisé de mettre les cornes dans le tiroir d’un meuble ancien.
« — On a des meubles qui partent en Angleterre toutes les semaines, dit-il, si tu vois ce que je veux dire.
— Enfin, ça nous regarde pas, dit Phillips. Ce n’est pas mon problème. C’est le vôtre. Je ne veux juste pas que ça nous retombe dessus, à mon cousin et à moi.
— Ça vous retombera pas dessus, fais-moi confiance », le rassura Mike.
Puis, deux mois plus tard, ils procédèrent à l’échange. Mais Phillips était toujours aussi nerveux.
« — Je te promets qu’il n’y aura pas de problèmes, Curtis, lui dit Richard. Crois-moi sur parole – tout se passera bien.
— Je ne te connais même pas, Richard, dit Phillips.
— Je sais, je sais, je sais… répondit Richard.
— Et tu ne me connais pas non plus.
— Tout ce que je peux te promettre, c’est qu’il y aura pas de problèmes, poursuivit Richard. Je peux jeter un œil ?
— Oui, mais je… Je suis quand même encore un peu nerveux, tu comprends ?
— T’inquiète pas, Curt’, réitéra Richard.
— Je peux t’accompagner, proposa Mike. Trouve-moi du whisky et je serai nerveux avec toi. »

Une corne de rhinocéros noir
Service américain de la protection de la faune et de la flore
Crédits : Bureau du procureur du District sud de New York
Enfin, Phillips sortit un sac plastique et une boîte FedEx qu’il avait planqués dans la maison. « Bien… Eh voilà… », dit-il, révélant une paire de cornes de rhinocéros assorties de deux cornes uniques. Curtis avait dit vrai ; c’étaient des spécimens d’une belle qualité, le plus grand atteignant les 40 centimètres. Mike regarda Phillips tout en essayant de cacher son excitation. Mike éplucha une large liasse de billets – des euros, « la monnaie internationale», expliqua Richard – et les déposa sur une table basse.
« — Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. C’est bon ?
— Je suis très nerveux », objecta Phillips une dernière fois, alors que Mike et Richard s’apprêtaient à quitter les lieux.
« — Une fois de plus, ne t’inquiète pas, dit Richard.
— Je… je ne sais pas si je le referai, dit Phillips. J’ai peur de me réveiller avec des menottes demain matin parce que vous vous serez faits attraper.
— Mais non, dit Mike. Bon sang…
— Conduisez prudemment, les gars », dit Phillips avant de verrouiller la porte derrière Mike et Richard.
Les deux Irlandais venaient de refermer les portières de leur Jeep lorsque deux voitures surgirent et se garèrent, une devant, une derrière eux. Quatre hommes armés sortirent des véhicules et cernèrent celui de Mike et Richard – des officiers en uniforme qui connaissaient Curtis Phillips sous son vrai nom, Curtis Graves, un agent infiltré qui travaillait au sein de la Division des Opérations Spéciales du Service américain de la protection de la faune et de la flore. Ils ordonnèrent aux deux Irlandais de sortir de leur véhicule.
Les Voyageurs
Michael Hegarty et Richard O’Brien étaient une énigme pour Curtis Graves. Leurs passeports avaient été tamponnés en Chine, en Afrique du Sud et au Canada, et tandis qu’il préparait son opération d’interpellation, Graves se rendit compte qu’ils étaient plutôt du genre précis et intelligent – Hegarty avait même volontairement omis 150 € dans la liasse de billets qu’il lui avait remise quelques minutes avant son arrestation. « Ils savaient ce qu’ils faisaient », me confirma Graves. Mais la troisième fois qu’il vit Hegarty et O’Brien, à l’intérieur du tribunal fédéral de Denver, leur comportement avait drastiquement changé.
« Ils se comportaient comme des gamins de quatre ans, littéralement, dit-il. Ils avaient tellement peur. » Sur le chemin de la prison vers le tribunal, un autre agent lui dit qu’ils « avaient peur des mecs aux crânes rasés et aux tatouages imposants – ils étaient sûrs qu’ils allaient se faire assassiner. Ils pleuraient en demandant : “Pourquoi est-ce qu’on est là ?” » Après que le chasseur de gros gibier – en fait un informateur que le service de Graves avait recruté au cours d’une précédente affaire – organisa le premier rendez-vous avec eux en septembre, Graves entra les noms d’Hegarty et O’Brien dans sa base de données, et ne trouva rien.
Quand les agents de la maison mère, à Arlington, en Virginie, demandèrent à leurs homologues étrangers des informations sur les deux Irlandais, ils apprirent qu’Interpol et Europol, deux agences de police internationale, avaient déjà entendu parler d’eux. Des officiels des deux organisations révélèrent aux Américains que les deux hommes faisaient partie d’un réseau distendu de familles en Irlande, dont certains membres faisaient partie des Vagabonds de Rathkeale.
Graves n’avait jamais entendu parler des Vagabonds, mais alors qu’il négociait avec John Sullivan – que Graves imaginait n’être qu’un pseudonyme utilisé par Richard O’Brien – il lui semblait avoir décelé ce qui pouvait être le signe d’une organisation relativement bien en place. Lorsqu’ils avaient échangé au téléphone peu après leur premier rendez-vous, Sullivan assura à Graves qu’il obtiendrait un bonus généreux pour avoir officié en tant qu’apporteur d’affaire – « Ça paie bien d’être le mec qui fait le lien », lui avait-t-il dit – et apaisa ses craintes quant à la possibilité de se faire arrêter par la police. « Crois-moi, écrivit Sullivan dans un de ses e-mails, ON N’A JAMAIS PERDU UNE CORNE LORS DU PASSAGE EN DOUANE, et on a tellement de contacts et de gens qu’on arrose aujourd’hui qu’on peut faire passer n’importe quoi dans n’importe quel pays d’Europe. »
Au départ, Graves voulait qu’O’Brien et Hegarty partent avec les cornes dans l’espoir qu’ils compromettent, sans le savoir, le reste de leur réseau. Mais la police du comté de Limerick l’en dissuada. « C’est hors de question, lui dit l’un des officiers. Leur réseau est trop opaque. » Les Vagabonds de Rathkeale, lui expliqua la police de Limerick, appartenaient à un groupe un peu particulier, qui vivait en marge de la société irlandaise depuis des siècles. On les appelait souvent « les Gitans irlandais », bien qu’ils n’eussent aucune espèce de lien avec ladite communauté.
En fait, ils n’avaient rien de génétiquement ou de religieusement différents des autres Irlandais, et n’étaient même pas considérés comme une minorité culturelle. Seul leur style de vie dénotait. C’étaient des nomades qui passaient beaucoup de temps sur les routes, et cela leur donna le surnom qu’ils portent depuis longtemps. On les appelle les Voyageurs.

Des enfants jouent à Cherry Orchard
Un camp de Voyageurs aux environs de Dublin
Crédits : Alen MacWeeney
Personne ne peut dire d’où viennent les Voyageurs Irlandais. Avant le XIXe siècle, leur histoire ressemble à un gigantesque fourre-tout duquel les historiens et les anthropologues ont tissé des théories, aucune n’étant véritablement satisfaisante. On a d’abord pensé que les ancêtres des Voyageurs étaient des commerçants itinérants qui arpentaient l’Irlande au Moyen-Âge, ou des paysans sans terre jetés sur la route suite aux déconvenues sociales et économiques qui ravagèrent l’Irlande au cours de son Histoire – un peuple qui, après avoir été rejeté par les sédentaires, les rejetaient à son tour.
Une autre théorie suggère que les Voyageurs sont les derniers descendants d’une culture nomade irlandaise qui précède l’arrivée des Vikings et des Normands – et que c’est en fait l’Irlande qui a tourné le dos à la culture des Voyageurs, et non l’inverse. Il est aussi possible qu’elle vienne de plusieurs endroits à la fois. Une étude datée de 1952 demandait aux Irlandais leur avis sur l’origine des Voyageurs. Les réponses allaient de « ils sont les descendants des princes et rois irlandais » à « ce sont les enfants perdus d’Israël ».
Le seul point qui fait peu débat est qu’à l’aube du XIXe siècle, les Voyageurs étaient regroupés en familles et vivaient à la périphérie des villes dans des tentes et des maisons de fortunes, faites de bois et de tissu. Ils parlaient leur propre langue, appelée « l’insipide » ou « le jambon », un patois qui se parle rapidement, issu du gaélique et de l’anglais irlandais. Ils bougeaient sans cesse, mais sur de courtes distances, leur horizon se limitant à un ou deux comtés.
Au début du XXe siècle, la plupart des Voyageurs vivaient dans des roulottes, et ces véhicules cylindriques décorés de tissu vert et tirés par des chevaux pie deviendraient l’un des emblèmes de ces pionniers errant dans l’imaginaire collectif. Beaucoup étaient rétameurs, marchands ambulants, vendaient des ânes ou des chevaux ou encore proposaient leurs services aux fermes qu’ils croisaient sur leur route. Ils étaient ce que les anthropologues appellent une société atomique, organisée autour d’unités familiales soudées et à l’écart d’autres groupes de Voyageurs ou de la société sédentaire. Leurs expériences firent de ce peuple des entrepreneurs de talent, et ils avaient la réputation d’être de fins observateurs de la nature humaine, tout en étant d’une vigilance alerte lors de leurs rencontres avec les communautés qu’ils croisaient.
Les sédentaires étaient méfiants à l’égard des Voyageurs. Ils les considéraient comme des bannis ou, dans le meilleurs des cas, comme des populations chapardeuses. En réaction à cela, beaucoup de Voyageurs se glorifiaient de jouer des tours aux sédentaires, soit en menant une négociation qui finirait clairement à leur avantage, soit en les arnaquant carrément. Cela dit, les deux cultures étaient symbiotiques. Les Voyageurs réparaient les outils fermiers des propriétaires et des paysans, vendaient des marchandises auxquelles les villes avaient difficilement accès, et proposaient leurs services en tant que travailleurs saisonniers. Les Irlandais payaient les Voyageurs pour leur travail et toléraient les petits méfaits comme le vol de légumes, la violation de domicile ou toute forme d’arnaque. La modernité détricota cette relation fragile.
Des événements tels que l’exode rural, l’industrialisation de l’agriculture et le remplacement du métal par le plastique diminuèrent drastiquement le niveau de vie des Voyageurs. Leur rythme de vie, basé sur la subsistance, et qui n’avait guère évolué depuis ses origines jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s’écroula en une quinzaine d’années. Les Voyageurs s’installèrent en périphérie des villes d’Irlande et d’Angleterre, attirés par les allocations étatiques et le métal rejeté par les chantiers des villes, et le commerce de ce matériau devint leur première source de revenus. Leur proximité avec les centres urbains tendit leurs relations avec les Anglais et les Irlandais sédentaires.
« Le chiffonnier est une relique du passé et n’a pas sa place dans la ville moderne, où les gens vivent de manière ordonnée, fixe et forment une société d’entraide mutuelle », déclara un conseiller municipal de Birmingham au Guardian en 1963. « Nous avons l’intention de rendre la vie de ces vautours humains si intolérable, si inconfortable et si dépourvue d’opportunités qu’ils ne resteront pas longtemps ici. » Le gouvernement irlandais voyait les Voyageurs comme une minorité défavorisée qui serait bien mieux lotie s’ils s’intégraient dans la société irlandaise, et au début des années 1960, des programmes de relogement, de scolarisation et d’aide au retour à l’emploi furent mis en place pour aider les Voyageurs à entrer dans le giron de l’État-providence.
Beaucoup de Voyageurs se sentirent démunis, « et il y avait des questionnements tout à fait légitimes de la part des Irlandais sédentaires, qui se demandaient si leur système allait être capable d’absorber cette communauté », m’expliqua Sharon Gmelch, une anthropologue américaine qui publia les premiers travaux exhaustifs sur les Voyageurs, au début des années 1970. « Peu de gens considéraient le nomadisme comme un choix. »
Les Voyageurs qui se sont le mieux intégrés à la société moderne sont ceux qui n’y ont pas totalement adhéré.
L’effort d’intégration fonctionna sur un point : au passage à l’an 2000, plus de deux tiers des Voyageurs irlandais avaient adopté un style de vie sédentaire, selon le recensement de 2002. Mais la même étude fournit des indications stipulant que l’effort échoua sur d’autres aspects du problème. 22 % des Voyageurs en âge de travailler – et près de 70 % de ceux qui se considéraient comme encore aptes au travail – étaient au chômage. Quand Gmelch revint en Irlande récemment pour rendre au visite aux Voyageurs qu’elle avait rencontrés près de quarante ans auparavant, elle fut bouleversée d’apprendre que la plupart d’entre eux avait un parent qui s’était donné la mort ; le taux de suicide parmi les Voyageurs, selon le projet national de sensibilisation au suicide au sein de la communauté des Voyageurs, est six fois plus élevé que le taux normal.
Les Voyageurs qui se sont le mieux intégrés à la société moderne sont ceux qui n’y ont pas totalement adhéré ; bon nombre d’entre eux n’avaient pas voulu abandonner leur vie nomade. Ces derniers faisaient partie d’une classe émergente de commerçants qui avaient réorienté leur talent d’acheteur et de vendeur vers le marché de l’antiquité, de l’import-export et de la construction de logements. Ils avaient échangé leurs chevaux contre des camping-cars et roulaient de campements en parkings pour poids lourds en Irlande et en Angleterre, et parfois en Europe continentale ou aux États-Unis, pour proposer leurs services.
Dans de nombreux cas, les Voyageurs restaient très traditionnels : ils se mariaient dès l’adolescence, étaient très conservateurs à propos des relations sexuelles hors mariage et du rôle de l’homme et de la femme au sein du foyer, et leur société s’organisait toujours autour de la cellule familiale. Mais certaines communautés – chaque communauté possède presque une culture propre – avaient aussi développé un goût certain pour le consumérisme contemporain : voitures de luxe, cérémonies de mariages et de première communion spectaculaires, Rolex tape-à-l’œil pour les garçons, auto-bronzant et robes bling bling pour les filles. Cet aspect de la vie moderne des Voyageurs fascinaient tout particulièrement les Anglais et les Irlandais.
En 2010, quand Channel 4, une chaîne de télévision britannique, commença à diffuser une émission de télé-réalité intitulée My Big Fat Gypsy Wedding (littéralement « mon bon gros mariage gitan »), qui avait pour sujet principal les unions de Roms ou de Voyageurs, ce fut le plus gros succès d’audience de la chaîne pour un programme non-scripté.

Un mariage sur Roche’s Road
Rathkeale, à l’approche de Noël
Crédits
Au-delà du titre, l’émission était sujet à controverse, même si elle semblait en jouer ; quand le show débarqua aux États-Unis, New Republic estima que c’était un programme « voyeur, rempli de clichés, donneur de leçons et vide », des épithètes peu éloignés du slogan de TLC, la chaîne câblée qui diffusait My Big Fat Gipsy Wedding en Amérique du Nord : « incroyable et scandaleux ». Mais les audiences reflétaient aussi la curiosité des téléspectateurs pour ces communautés. Un Irlandais qui voudrait essayer d’expliquer à un Américain le style de vie des Voyageurs comparerait peut-être ce dernier à celui des Amish.
Une comparaison par l’absurde, évidemment, dans le seul but de s’en amuser : si on lui décrivait un jeune Amish à la barbe parfaitement taillée arrivant dans la ville de Lancaster, en Pennsylvanie, au volant d’une Bentley Continental, peut-être un Américain pourrait-il avoir une petite idée du style de vie des Voyageurs. Tous les Voyageurs n’étaient pas aussi aisés que ce qu’ils voulaient faire croire, mais un groupe en particulier affichait une richesse bien réelle. On les avait affublés d’un sobriquet qui convoquait à la fois la médisance et l’envie. On les appelait les Voyageurs Gucci, et ils venaient tous d’une petite ville du nom de Rathkeale.
Un certain O’Brien
Les premiers Vagabonds de Rathkeale qui firent fortune étaient les vendeurs de chevaux : puis vinrent les vendeurs de tapis, qui sillonnaient l’Angleterre avec leur marchandise. Au cours des années 1970, même les Voyageurs de l’autre bout du royaume – habitués à considérer les Voyageurs irlandais comme une sous-classe de leur communauté et qu’ils appelaient les « brutes » – avaient entendu parler des maisons des habitants de Rathkeale. Au début, ces propriétés étaient entassées sur une seule rue, appelée Roche’s Road, qui partait depuis la rue principale et courait jusqu’à la frontière orientale de la commune.
Au cours des années 1990, les Voyageurs avaient racheté plusieurs quartiers, aisément identifiables par le flâneur ou le voyageur qui passait par le village avant d’atteindre sa destination. On y trouvait des maisons mitoyennes rénovées, mais aussi des manoirs typiquement américains, ersatz de demeures coloniales ou d’haciendas mexicaines, de véritables palaces au vu des standards en vogue dans les petits villages irlandais. Ces propriétés étaient pour la plupart en excellent état ; les peintures étaient neuves et les arrangements floraux parfaitement entretenus, du granit encerclait les fenêtres et un champ de gravier remplaçait parfois les jardins. Le tout gardé par des murs de briques et des portails en fer. Les propriétaires occupaient rarement les lieux et baissaient des rideaux de fer devant leurs fenêtres pour signifier leur absence.
Pour les cinq mille Voyageurs qui se définissaient comme appartenant aux clans de Rathkeale, la ville était un havre de recueillement spirituel. Ils y enterraient leurs morts, y baptisaient leurs enfants et y célébraient les fêtes importantes. Quand les enquêteurs américains commencèrent à faire parler les Vagabonds de Rathkeale arrêtés dans le Colorado, ils réalisèrent que pour mieux comprendre la communauté à laquelle ils avaient désormais à faire, ils allaient devoir se plonger dans un livre intitulé The Outsiders, publiés par un imprimeur de Dublin quelques années plus tôt. L’auteur était un journaliste d’investigation du nom d’Eamon Dillon.

Eamon Dillon
Journaliste irlandais enquêtant sur l’affaire
Crédits
J’ai récemment rencontré Dillon dans un pub de Dublin, non loin des bureaux du journal Sunday World, où il a travaillé pendant treize ans en tant que journaliste. Dillon a 46 ans et arbore un bouc poivre et sel ; quand je l’ai rencontré, il portait un costume à carreaux et avait une attitude de journaliste spécialisé dans les faits divers qui serait revenu de tout, une sorte de vétéran, et fier de l’être.
Dillon avait fait la rencontre des Vagabonds de Rathkeale par accident. Il était encore une jeune recrue au World, et son patron lui avait demandé d’écrire un papier sur les dix Voyageurs les plus riches d’Irlande. Dillon connaissait la ville ; il y avait couvert une affaire d’homicide, événement assez rare pour la petite ville. Un jeune Voyageur du nom de Paddy « Crank » Sheridan avait poignardé son beau-frère, David « Tunny » Sheridan, avec un tournevis après une dispute alcoolisée. Sur place pour évoquer l’affaire, Dillon, qui avait un contact à Rathkeale, réactiva sa source pour lui demander si quelqu’un dans son entourage pouvait être considéré comme un des dix Voyageurs les plus riches d’Irlande.
« Il m’a répondu : “Oh oui, on a des gars dans ce genre ici”, me confia Dillon. Et il a commencé à me raconter des histoires. » Aucun des Vagabonds ne daigna parler à Dillon ; ils ne s’adressaient que très rarement à des journalistes. Mais alors que Dillon commençait à dresser le portrait de la communauté, il se rendit compte qu’une vingtaine de Voyageurs composaient une sorte d’élite – formée de patriarches et de leurs fils – qui pesaient entre 275 et 690 millions de dollars. Ils avaient des affaires dans des dizaines de pays. Leur éthique de travail fascinait Dillon.
« Ces types pouvaient être assis au bar, avoir une simple conversation comme celle que nous avons maintenant, me dit-il, mais quand quelqu’un entrait en disant : “Il se passe quelque chose à Munich. Il faut qu’on parte sur le champ”, ou bien à Prague, ou à Cracovie, les mecs partaient. Et si ton fils de 10 ans est avec toi à ce moment-là, il part aussi. » Dans son livre, Dillon décrit le prototype du businessman qui vivait dans la communauté des Voyageurs de Rathkeale. Celui-ci porte un nom : Richard « Kerry » O’Brien. « Le businessman ultime au sein de la communauté. »
À Rathkeale, Dillon a même découvert qu’on appelait O’Brien « le roi des Voyageurs » – un titre honorifique parfois donné au plus influent des membres de la communauté (bien que beaucoup estiment que ce genre de sobriquets est un moyen comme un autre de gonfler l’aura mystique dont les Voyageurs jouissent auprès des sédentaires). Autrefois antiquaire prospère, O’Brien s’était diversifié dans la manufacture d’aluminium au milieu des années 1990, allant jusqu’à acheter une usine de gouttières dans le comté de Cork.
Alors que l’immobilier connaissait une croissance exponentielle, il vendit son usine et commença à importer des meubles asiatiques en Irlande. Il se revendiqua même comme le plus gros importateur de cheminées en fer de tout le pays. La police irlandaise soupçonnait les Voyageurs de Rathkeale d’avoir des sources de revenus plus obscures que celles décrites par O’Brien. Une proportion conséquente de ces dernières – selon Dillon, on tournait autour des 140 millions de dollars annuels – provenait d’une arnaque tellement énorme qu’elle était, au début, difficilement crédible. Le coup, que les Voyageurs pratiquaient déjà depuis des années, était connu sous le nom de « goudronnage ». Les arnaqueurs voyageaient dans toute l’Europe en petites équipes – deux Voyageurs chargés de la supervision et un groupe de gadjos payés au lance-pierre.
En général, un jeune homme propre sur lui toquait aux portes des riverains et se présentait comme le chef d’un chantier qui devait rénover une portion de la voirie, non loin du domicile de ses proies. Comme les ouvriers disposaient d’un peu de goudron en plus, il proposait aux habitants de refaire leur allée pour quelques milliers d’euros. Si le propriétaire acceptait, la fine équipe s’exécutait, récoltait son dû et partait. L’arnaque était découverte au premier jour de pluie : l’asphalte promise n’était en fait qu’un mélange de gravier et d’huile de moteur, qui se décomposait et coulait à son premier contact avec de l’eau. Au moment de la révélation, les Voyageurs étaient déjà loin. L’efficacité de la ruse repose dans sa modestie.
Il arrivait à ces ouvriers d’un nouveau genre de se faire arrêter (à l’été 2009, une équipe venue de Rathkeale fut appréhendée en Italie après avoir essayé d’entuber les nonnes d’un couvent près de Milan ; les bonnes sœurs avaient flairé l’arnaque et prévenu la police, qui dépêcha un officier, déguisé en prêtre, pour prendre les Voyageurs en flagrant délit.) Mais c’était tout à fait le genre d’entourloupe à laquelle les forces de l’ordre ne prêtaient que peu d’attention, surtout lorsqu’il était souvent difficile de prouver que les plaignants avaient été victimes d’une arnaque à proprement parler. « C’est un truc de petits malins », m’avoua un agent du Bureau des Ressources Criminelles (BRC) d’Irlande, l’agence en charge de faire respecter la loi dans le pays, « d’un coup, à la première pluie, on se rend compte que les ouvriers étaient incompétents. Au pire c’est du civil ; pas du pénal. »
Quand les autorités tentèrent de mettre la main sur le gang, leur identification se révéla problématique.
D’autres Voyageurs de Rathkeale furent suspectés de faire le commerce de contrefaçons importées de Chine. « Ils mettent la main sur des conteneurs remplis d’iPhones, d’iPads, de vêtements en cuir de mauvaise qualité ou de meubles non-conformes avec les standards de sécurité européens », me dit l’agent du BRC – un des deux officiels que j’ai pu rencontrer à Dublin, et qui accepta de me parler à la seule condition de pouvoir conserver son anonymat. Plus célèbres étaient les générateurs qui fonctionnaient au diesel, reçus en marque blanche, qui souffraient souvent de dysfonctionnements, parfois aux risques et périls de clients quelque peu naïfs.
En juin 2009, une poignée de Voyageurs se trouvait en Australie, où ils vendirent pour plus de 400 000 dollars de ce type de matériel, avant d’être arrêtés à Sydney et de voir leur cargaison saisie. Les vendeurs rentrèrent en Irlande, sans être inquiétés. Quand les autorités tentèrent de mettre la main sur le gang, leur identification se révéla problématique. Comme d’autres Voyageurs, ceux de Rathkeale partagent souvent le même nom de famille, voire le même prénom. Les enquêteurs avaient rapporté leur interrogatoire d’un certain Danny O’Brien, habitant à Rathkeale, pour réaliser ensuite qu’il y avait une douzaine de Danny O’Brien dans le village, tous nés dans un créneau de 24 mois. Pour les distinguer, il fallait connaître les surnoms donnés à chacune des familles – et faire la différence entre, mettons, les « Bishop » O’Brien et les « Turkey » O’Brien. De plus, les Voyageurs se présentaient rarement à leurs procès, même pour des infractions mineures. Une seule fois, l’un d’entre eux fut interrogé pour un crime plus sérieux.
En mai 2004, quatre Voyageurs de Rathkeale, tous jeunes, furent interpellés sur une aire d’autoroute des Flandres Occidentale, en Belgique, non loin de la frontière française, alors qu’ils tentaient de faire passer des cartouches de cigarettes. En conséquence de la non-harmonisation des taxes sur les produits tabagiques en Europe, ces derniers coûtaient un cinquième de leur prix anglais en Belgique ; les hommes de Rathkeale, selon la police fédérale belge, graissèrent la patte de certains camionneurs pour les inciter à transporter pour 2,8 millions de dollars de tabac à rouler à travers la France et le Tunnel sous la Manche. Les Belges arrêtèrent et jugèrent les trafiquants.
« Pour les condamner », me raconta Dillon, qui couvrit les procès qui eurent lieu à Bruges, « la police dut prouver que les Voyageurs fonctionnaient de manière extrêmement organisée, avec une hiérarchie, que c’était une sorte de joint-venture du crime et qu’ils menaient ce petit trafic depuis plus d’un an. Ils y parvinrent. » L’un des accusés, âgé de 19 ans, s’appelait Richard O’Brien – le même que Curtis Graves arrêterait six ans plus tard à Commerce City.
Comme il le fit dans le Colorado, devant le juge belge, O’Brien joua la carte de la naïveté, du petit gars tombé dans la criminalité par accident, jurant ses grands dieux qu’il n’était qu’un simple routard tombé par hasard entre les mains des Voyageurs dans un hôtel, et il pria le magistrat de le laisser retourner en Irlande où il devait finir ses études. Le juge ne se laissa pas attendrir et donna à chacun des accusés une peine de neuf mois de prison. Avant la fin du procès, O’Brien dit à ses avocats : « Je ne sais pas ce que j’ai fait pour mériter cela. »
Le crescendo
Plus il en apprenait au sujet des Vagabonds de Rathkeale, plus Curtis Grave était convaincu que l’opération de commerce illégal de cornes de rhinocéros qu’il était parvenu à infiltrer n’était que la partie émergée d’un iceberg colossal, et il était décidé à le prouver. Mais lorsqu’il rassemblait les éléments qu’il avait à sa disposition, m’avoua-t-il, il se retrouvait encombré d’ « articles de journaux », plutôt que de preuves tangibles. Hegarty et O’Brien plaidèrent coupable pour minimiser les accusations de contrebande, et furent condamnés à six mois de prison et à six mois d’assignation à résidence.
Peu après leur arrestation, au cours d’une audition, Linda McMahan, l’assistante du procureur général en charge du dossier, tenta de convaincre le juge de prendre en considération le caractère organisé du petit trafic qu’ils avaient mis à jour. « L’un d’entre eux a déjà été condamné pour des faits similaires : conspiration en vue de contrebande, dit-elle au juge. Ils font partie d’un groupe itinérant de… » « Stop », lui répondit le juge, lui coupant la parole. « Ils ne font partie de rien. » Au final, tout ce que l’accusation avait entre les mains était qu’ils avaient arrêté deux hommes qui tentaient d’acheter des cornes de rhinocéros.
« Les Vagabonds de Rathkeale », souffla Craves, appuyant le caractère étrange de ce surnom. « On dirait le nom d’un groupe qui jouerait dans un pub. » Au moment où l’affaire fut classée, les agents du service de protection de la faune et de la flore découvrirent qu’un troisième Vagabond recherchait des cornes de rhinocéros sur le territoire américain. En septembre, Richard Slattery, un cousin de Richard O’Brien âgé de 24 ans, s’était rendu à Houston, au Texas, avait loué un 4×4, conduit jusqu’à Austin, où lui et deux de ses partenaires avaient tenté d’acquérir une tête de rhinocéros mise aux enchères ce jour-là. Le commissaire-priseur refusa l’offre de Slattery ; la loi texane imposait que ce genre de trophée fût vendu à un résident de l’État.
Le jour suivant, Slattery ramassa un S.D.F. local, le conduisit jusqu’à la salle des ventes et lui remit 18 000 dollars en coupures de 100 pour acheter la tête à sa place. Deux mois plus tard, Slattery pénétra dans la Rose House, un salon de thé anglais dans un centre commercial de Flushing, dans le Queens. Un acheteur chinois l’y attendait. Ce jour-là, non seulement Slattery vendit les cornes qu’il avait retirées de la tête de rhinocéros acquise au Texas, mais aussi une autre paire de cornes qu’il avait acquises plus tôt. L’acheteur lui tendit trois chèques bancaires d’une valeur totale de 50 000 dollars. Lorsque les agents de la protection de la faune et la flore eurent vent de la transaction, quelques jours avant Noël, Slattery était déjà de retour en Irlande.
~
Quatre jours après l’arrestation d’O’Brien et Hegarty dans le Colorado, une vingtaine de policiers européens se donnèrent rendez-vous au siège d’Europol, à La Haye. John Reid, un agent irlandais qui servait de liaison avec la Garda Siochana, ou Gardai, la police nationale irlandaise, avait convoqué tout le monde. Son job était de traiter les demandes des polices de toute l’Europe en rapport avec des méfaits commis par ses compatriotes sur d’autres territoires que le leur.
À la fin de l’été 2010, il était probablement plus simple pour Reid de lister les pays d’Europe de l’Ouest qui n’avaient pas fait l’objet d’une demande particulière au sujet d’une bande d’étranges Irlandais du comté de Limerick qui vendaient des générateurs en mauvais état et arnaquaient les citoyens avec du goudron de pacotille, que l’inverse. Les demandes de ses collègues étaient si similaires, me dit Reid, qu’en septembre, il décida « que la meilleure chose à faire était de prévenir les diverses agences de police qu’ils avaient à faire à la même bande ». À La Haye, les enquêteurs témoignèrent un par un. « La question qui revenait, dit Reid, c’était : “Qu’est-ce qui se passe et est-ce que ça va aller en s’empirant ?” »

Jeremiah et Michael O’Brien
À la sortie du tribunal Ennis Circuit Court
Crédits : Liam Burke/Press 22
Les choses allèrent en s’empirant. Les premiers rapports qui traitaient des habitants de Rathkeale et les liaient à la contrebande de cornes de rhinocéros furent rédigés en janvier, quand deux Voyageurs dénommés Jeremiah et Michael O’Brien – des frères d’une vingtaine d’années venant de la famille « Bishop » O’Brien – furent arrêtés par des douaniers à l’aéroport de Shannon, en Irlande, en route vers le Portugal avec huit cornes dans leurs valises.
Le BRC avait été prévenu de leur présence sur le vol, mais personne ne sut quoi faire de ces deux gaillards. « D’abord, m’expliqua un agent, on se disait : “Qu’est-ce qu’on a à voir là-dedans ? Et, bon sang, qu’est-ce que ces Voyageurs foutent avec des cornes de rhinocéros ?” » Mais quand les informations commencèrent à leur parvenir – les sollicitations insistantes auprès des chasseurs de gros gibier et des taxidermistes, les apparitions répétées des Vagabonds dans les salles des ventes en Angleterre – Reid remarqua que les événements se répétaient.
Avant de prendre son poste à La Haye, il avait passé vingt ans dans la police en Irlande, et il connaissait les Vagabonds de Rathkeale. « Ils étaient, comment dire… je ne vais pas dire célèbres, me dit-il. Mais ils avait une petite réputation parmi les communautés de Voyageurs – une réputation de businessmen, si je puis dire… » La nouvelle de l’arrestation d’O’Brien et Hegarty dans le Colorado attira immédiatement son attention, car il reconnut les noms des jeunes hommes : ils étaient respectivement le fils et le gendre de Richard « Kerry » O’Brien – le Roi des Voyageurs de Rathkeale. Bien que le vieil O’Brien ne fût jamais accusé de crime – ni même suspecté d’en avoir commis un, selon un enquêteur Irlandais à qui j’ai pu parler –, Reid savait que le patriarche avait des affaires en cours en Chine. Reid essayait toujours de démêler le vrai du faux dans cette affaire quand les gardiens du zoo de All-Weather, de Münster, en Allemagne, après avoir fait leur ronde matinale, le jour du Nouvel An, découvrirent une fenêtre brisée dans un petit bâtiment.
À l’intérieur, la portière en verre d’un cabinet qui abritait une petite exposition de produits issus du braconnage, montrés pour sensibiliser le public à ces questions, avait été dévissée. Il y manquait le pelage d’un singe, celui d’un léopard, une demi-douzaine de pièces d’ivoire et trois cornes de rhinocéros.
Le 21 février 2011 à 20 h 15, moins de deux mois après le braquage du Zoo de Münster, une voiture-bélier détruisit la vitrine blindée d’une salle de vente à 800 mètres du village de Stansted Mountfitchet, au nord de Londres. Quand la police arriva, dix minutes après les faits, le véhicule avait déjà filé. Tout comme la tête de rhinocéros qui trônait sur un muret dans la vitrine. Le vol du Zoo de Münster aurait pu passer pour un incident isolé, mais Guy Schooling, le gérant de Sworders Auctioneers, la salle des ventes de Stansted Mountfitchet, était convaincu du contraire. Comme d’autres antiquaires, il gardait un œil sur le prix des cornes de rhinocéros.
« Je me suis fait un petit paquet en vendant ces cornes, me dit-il. Je n’ai pas particulièrement apprécié le faire, mais je répondais à la demande chinoise » – et mieux valait, selon lui, que ces clients se fournissent en achetant les restes d’un animal mort il y a des décennies plutôt qu’en alimentant le braconnage d’une espèce en voie de disparition. Peu avant le vol, la communauté européenne avait encore décidé de resserrer la législation concernant l’exportation de cornes de collection. Sworders comptait en vendre huit, en plus de la tête, dans sa salle des ventes, le 22 février, lors d’une sorte de grande braderie avant la mise en œuvre de la nouvelle législation.

Rhinocéros du zoo de All-Weather
Münster, Allemagne
Crédits : Dirk Vorderstraße
Après une tentative de braquage deux semaines avant la vente, la salle de vente avait déplacé ses cornes dans une chambre forte, mais laissa la tête à son emplacement initial. « Elle était fixée au mur ; on pensait que ça n’allait pas poser de problème », me dit Schoolings. Mais les voleurs, après avoir défoncé la porte d’entrée du bâtiment, descellèrent la tête et filèrent par la porte arrière de la salle, qui donnait sur une vaste plaine. La tête, délestée de ses cornes, fut retrouvée quelques jours plus tard dans un fossé près de la route, à 45 kilomètres de là. La police visionna les bandes des caméras de surveillance, mais les voleurs portaient des chapeaux avec les rebords baissés, ce qui dissimulait leur visage.
Le 5 mars, le Muséum d’histoire naturelle de Rouen, en France, signifia aux autorités qu’une corne de rhinocéros manquait dans sa collection permanente. Un mois plus tard, les cambrioleurs avaient encore frappé, cette fois-ci à l’Université de Coimbra ; le numéro de portable irlandais que la police retrouva dans les méandres du relais téléphonique qu’ils avaient scrupuleusement scanné appartenait à la femme d’un Vagabond très en vue. Vers 2 h, le matin du 27 mai, des voleurs pénétrèrent dans le Musée pédagogique d’Haslemere, dans le sud-est de l’Angleterre, et s’enfuirent avec la tête d’un rhinocéros tué en Afrique de l’Est au début du XXe siècle par un lieutenant de l’armée britannique. Le personnel du musée était désormais plus vigilant, conscient que sa collection attirait des envieux mal intentionnés.
« C’était évidemment des criminels, me confia le conservateur du musée Paoloa Viscardi, qui n’auraient pas forcément su ce qui valait le coup d’être volé ici si on ne le leur avait pas dit en amont. » Les conservateurs commencèrent à échanger des histoires sur des événements qui se répétaient un peu partout en Europe. « Les gens appelaient et demandaient carrément : “Vous avez des cornes de rhinocéros ?” raconta Viscardi. Ou alors ils trainaient dehors et posait des questions aux visiteurs… » Les vols devenaient de plus en plus spectaculaires.
Le matin du 11 juin, deux Voyageurs de Rathkeale – Michael Kealy et Daniel « Turkey » O’Brien, emprisonnés en Belgique en compagnie de Richard O’Brien Jr pour contrebande de tabac – braquèrent un antiquaire dans le parking d’un McDonald’s à Nottinghamshire, en Angleterre, et lui volèrent une corne de rhinocéros que l’homme devait initialement leur vendre. Lorsqu’ils démarrèrent leur voiture, l’antiquaire parvint à se précipiter dans l’habitacle à travers une vitre à moitié fermée. Kealy et O’Brien passèrent la première et foncèrent, grillant des feux rouges, les jambes de l’homme dépassant de leur carrosserie, avant de s’en débarrasser. Il se blessa grièvement dans sa chute. Kealy fut arrêté une semaine plus tard, sur le point d’embarquer sur un ferry pour la France. O’Brien fut stoppé à Cambridgeshire en décembre, mais parvint à s’échapper et à fuir le pays.
Cinq jours après les événements de Nottinghamshire, les gardiens d’un musée de la ville de Liège, en Belgique, faisaient leur ronde au dernier étage du bâtiment, étage qui abritait l’aile du musée dédiée à la zoologie, quand ils virent un homme en train d’essayer de retirer une tête de rhinocéros de son socle. Le voleur les aspergea de gaz lacrymogène et quitta le musée avec son trophée sous le bras, arracha la corne et jeta le reste de la tête dans un bassin avant de rejoindre une voiture immatriculée en Hollande, qui l’attendait sagement à l’extérieur. Quand le voleur – un Polonais de 34 ans résidant aux Pays-Bas – fut appréhendé à un barrage de police, il dit aux enquêteurs qu’on lui avait demandé de laisser la corne au pied d’une statue dans la ville de Helmond, en Hollande, où il recevrait la somme de 3 000 euros.
Même Reid fut surpris par l’envergure géographique des activités criminelles des Vagabonds.
L’Association des Collections de Sciences Naturelles, basée à Londres, conseillait désormais à ses membres de « retirer les cornes de rhinocéros de leurs collections permanentes et de les mettre dans un endroit sûr ». En Italie, trois cornes furent dérobées du Hall des Squelettes au Muséum d’histoire naturelle de l’Université de Florence, le plus ancien musée ouvert au public en Europe. En Allemagne, les voleurs s’emparèrent d’une corne du Musée d’histoire naturelle de Bamber, en scièrent une autre d’un trophée exposé au Musée de la chasse de Gifhorn, et démontèrent la mâchoire supérieur d’un rhinocéros exposé au Musée zoologique de Hambourg.
Au début du mois de juillet, les voleurs de cornes s’attaquèrent au Musée d’histoire naturelle de Bruxelles, en bas de la rue où se trouve également le Parlement européen. Puis Blois, en France, vint s’ajouter à la liste ; ils allégèrent le musée d’un rhinocéros de près de 100 kilos et filèrent à bord d’un van. Deux semaines et demi plus tard, tôt un jeudi matin de la fin du mois de juillet, la police du comté de Suffolk, en Angleterre, apprit qu’un individu avait déconnecté l’alarme de la porte arrière du musée d’Ipswich – qui abritait un rhinocéros empaillé surnommé Rosie par des habitants fiers de cette mascotte un peu particulière. Une fois sur place, cinq minutes plus tard, les hommes ne trouvèrent à la place de Rosie qu’un tas de plâtre et de mastic.
Opération Feuille de Chêne
Europol décida qu’il était temps de rendre cette histoire publique. Le 7 juillet 2011, l’agence publia un bulletin identifiant les responsables de cette vague de vols comme un « groupe criminel organisé et mobile, impliquant des Irlandais et des personnes originaires d’Irlande ». En fait, John Reid estimait en savoir davantage que cette simple déclaration. Depuis le mois de novembre 2010, Reid et d’autres officiers de liaisons d’autres pays, tous basés à La Haye, n’avaient pas arrêté de se voir et partageaient toutes les informations à leur disposition au sujet des Vagabonds de Rathkeale – une collaboration plus connue sous le nom d’Opération Feuille de Chêne. Même Reid, qui pensait connaître le réseau de Rathkeale aussi bien que beaucoup de ses collègues, fut surpris par l’envergure géographique des activités criminelles des Vagabonds, qui avaient sillonné le monde à la recherche de cornes de rhinocéros, d’allées à goudronner et de clients naïfs à qui fourguer leurs générateurs défectueux.
« On s’est rendu compte qu’ils étaient passés par l’Amérique du Sud, l’Afrique du Sud, la Chine et probablement la Russie, me dit-il. Et toute l’Europe, en long, en large et en travers – même à Chypre. Il y avait des choses que j’ignorais dans le dossier, et je pense que la Gardai les ignorait également. » Pour Reid, qui avait un diplôme de second cycle en commerce international, les Vagabonds de Rathkeale posaient une étude de cas tout à fait remarquable pour un étudiant qui s’intéresserait à l’entrepreneuriat, tant de son point de vue légal que commercial – et surtout, Reid pensait qu’il avait enfin compris comment le réseau fonctionnait. « À un moment donné, me dit-il, il nous semblait que tous les Vagabonds de Rathkeale cherchaient des cornes de rhinocéros. » Alors que les infos s’amoncelaient sur les bureaux d’Europol, Reid avait localisé un motif précis dans cette toile immense. Les vols, pensait-il, étaient l’œuvre d’une petite douzaine de familles, toutes issues des Voyageurs de Rathkeale.

Quartiers généraux d’Europol
La Haye, Pays-Bas
Crédits : Europol
À Rathkeale, les clans, comme dans d’autres groupes de Voyageurs traditionnels, étaient organisés autour de la figure du patriarche, mais c’était loin d’être un système strict et figé. La figure tutélaire de ces groupes était en général un homme d’âge moyen qui avait atteint ce rang en faisant preuve de vertus et d’aptitudes certaines dans le monde des affaires. Sous ces figures, l’autorité se divisait parmi de nombreux fils, gendres et neveux. Ceux que Reid visait – ceux qui étaient « très actifs, qui présentaient pour nous le plus d’intérêt » – étaient au nombre de trente, environ.
Mais selon l’estimation de l’Irlandais, à n’importe quel moment, l’organisation familiale pouvait comprendre dix, peut-être vingt fois plus de membres susceptibles de jouer un rôle dans une opération criminelle. « Et cela devint un réseau vivant, m’expliqua-t-il. N’importe quand, n’importe qui, relié de près ou de loin à ce réseau tentaculaire, pouvait être impliqué dans un vol. Il pouvait s’agir de faire la reconnaissance d’un nouveau musée, ou envoyer de l’argent aux voleurs. »
Tôt dans la chronologie de l’Opération Feuille de Chêne, Reid fut étonné par l’omniscience des voleurs de cornes. Ils ne s’attaquaient pas seulement à des musées ou des salles des ventes connus, ils visaient aussi de petites propriétés dans les coins reculés de France, de Belgique et d’Allemagne. « Ces vols, dans ces petites villes perdues au milieu de la France, comment pouvaient-ils savoir qu’il y avait du rhino là-bas ? » Ce ne fut qu’après avoir interrogé un enquêteur français qui avait passé des mois à pister les arnaqueurs au bitume qu’il comprit enfin.
Les années passées à discuter avec les propriétaires de grands terrains disposés à faire refaire leur allée goudronnée permirent aux Vagabonds de dessiner une carte de la richesse en Europe – comprenant les châteaux qui abritaient une salle de chasse et les manoirs qui appartenaient à des familles au passé colonial. L’expérience acquise par cette minutieuse opération expliqua un autre aspect des vols de cornes. Le personnel des musées indiquait souvent avoir des visiteurs au fort accent irlandais, qui demandaient des informations supplémentaires au sujet des cornes de rhinocéros quelques semaines avant les cambriolages.
Mais au-delà de Michael Kealy et Daniel « Turkey » O’Brien, les seuls voleurs à avoir été appréhendés par les autorités ne faisaient pas partie des Vagabonds de Rathkeale ; c’étaient en général des immigrés d’Europe de l’Est, des Voyageurs de clans plus pauvres, ou bien des marginaux, des sans-abris ou d’ex-taulards avec peu d’espoir devant eux. Et ceux-ci correspondaient presque parfaitement aux portraits que les enquêteurs français avaient dressés des ouvriers qui posaient du mauvais goudron chez des particuliers.
« On savait que [les Vagabonds de Rathkeale] étaient impliqués dans le vol des cornes de rhinocéros, mais qui étaient donc ces étrangers qu’on arrêtait parfois et qui n’ont rien à voir avec les Vagabonds, me demanda Reid. Eh bien, c’était eux qui posaient le goudron. » Ceux que la police arrêtait ne donnaient que rarement le nom de leurs employeurs. Le 26 août 2011, un aristocrate autrichien indiqua que deux cornes de rhinocéros appartenant à sa famille depuis des générations avaient été volées de sa propriété dans la vallée viticole du Danube. La police locale arrêta les voleurs en janvier ; les trois hommes étaient de nationalité polonaise. Mais cette fois-ci, l’un d’entre eux – un homme de 30 ans, dénommé Damian Lekki – accepta de révéler l’identité de ses patrons. Les infractions qu’il commit furent toutes commanditées par un Irlandais qui se faisait appeler John Ross. Selon les documents que les procureurs autrichiens remplirent, Lekki « fut capable d’identifier scrupuleusement [Ross] à partir d’une photographie ».
L’homme était un Voyageur de Rathkeale qui s’appelait en fait John « Ross » Quilligan. L’Autriche émit un mandat d’arrêt européen demandant l’extradition de Quilligain depuis l’Irlande. « John Quilligan, comme l’expliquait le mandat, est fortement suspecté d’être membre d’un groupe criminel irlandais spécialisé dans le vol de cornes de rhinocéros. » Quilligan se battit des mois durant pour éviter l’extradition, allant jusqu’à la Haute Cour Irlandaise, qui le débouta une dernière fois en août 2013. Mais je ne suis pas parvenu à trouver une quelconque mention de l’affaire dans la presse autrichienne ou irlandaise depuis, et les procureurs autrichiens déclinèrent toutes mes demandes d’entretien. Quand je parlai de l’affaire à un des agents du BRC que j’ai interviewé, il rit jaune. Au moment où Quilligan fut livré à l’Autriche, m’expliqua-t-il, les voleurs étrangers avaient modifié leur déposition. « Il fut envoyé en Autriche un lundi, me dit l’agent. Il était de retour à Rathkeale le jeudi suivant. »

Le butin de Michael Slattery
Cornes de rhinocéros noir
Crédits : Bureau du procureur du District sud de New York
Mais les enquêteurs avançaient simultanément sur d’autres fronts. Au Portugal, la Police Judiciaire fouillait sans relâche les magasins d’antiquité locaux, à la recherche des voleurs de Coimbra. Bien qu’ils ne mirent pas la main dessus, ils tombèrent d’un personnage tout à fait intéressant : un antiquaire – un Australien résidant en Chine – était suspecté de servir de lien entre certains Vagabonds et des acheteurs en Chine.
La police retrouva sa trace à l’aéroport de Lisbonne en septembre 2011, alors qu’il embarquait pour Paris avec son fils, six cornes de rhinocéros dans ses bagages. Selon le bureau du procureur général du Portugal, l’affaire est toujours en cours. Les Vagabonds eux-mêmes, cependant, demeuraient introuvables. En revenant sur les pas de Michael Slattery aux États-Unis, les enquêteurs de l’agence de protection de la faune et de la flore commencèrent à saisir la sophistication des voleurs auxquels ils avaient à faire.
« Ils voyageaient en général avec un très peu de bagage », me raconta Andy Cortez, l’agent spécial en charge de l’affaire. « Ils se déplaçaient avec très peu d’argent sur eux – on leur transférait des fonds une fois arrivés à destination. Ils changeaient sans cesse de voiture de location. Ils utilisaient même des tactiques pour repérer des filatures ou de la surveillance : ils s’arrêtaient sans crier gare, faisaient brusquement demi-tour, pour voir si on ne les suivait pas. »
Quand ils voulaient rentrer au bercail, les Vagabonds de Rathkeale réservaient un vol, puis arrivaient à l’aéroport un jour avant le décollage pour acheter un nouveau billet pour le jour même, à chaque fois réglé en espèces. Ils travaillaient sans arrêt, « de l’aube jusqu’aux environs de 22 h, et bougeaient sans cesse, toujours accrochés au téléphone », dit Cortez. En examinant le relevé des trajets d’un Vagabond qui venait de quitter les États-Unis, Cortez s’aperçut que le bonhomme avait visité sept pays en treize jours avant de finalement atterrir en Irlande. Ils utilisaient plusieurs passeports, identités, adresses e-mail et téléphones.
Alors que la police s’escrimait à produire un arbre généalogique intelligible, ou simplement à compiler des informations souvent contradictoires, les officiers se rendirent compte que distinguer un Danny O’Brien d’un autre était un projet pharaonique. « À plusieurs occasions, dit Cortez, nous avons dû utiliser des photographies pour nous y retrouver. » Pourtant, un événement allait trahir la vigilance des Vagabonds, un événement qu’ils ne rateraient pour rien au monde. Chaque année, en décembre, ils se réunissaient dans la ville qu’ils appelaient leur domicile spirituel.
Noël à Rathkeale
Tous ceux avec qui j’évoquai les Vagabonds de Rathkeale m’expliquèrent que si je voulais en savoir plus à leur sujet, je devais aller à Rathkeale en décembre. Certains Voyageurs du coin revenaient chez eux pour Pâques ou pour la Saint-Patrick, mais ce n’était rien en comparaison de l’activité qui régnait dans le village pendant la période de Noël. Les garages privés, souvent vides, se remplissaient de voitures de luxe et de caravanes.
C’était la seule période de l’année où les familles se croisaient, et l’atmosphère pouvait se tendre. Les adolescents réglaient les querelles de clochers à coups de poing et de barre de fer au milieu de la rue principale, tandis que les filles, maquillées comme des voitures volées et engoncées dans leurs mini-shorts à paillettes, paradaient sur Roche’s Road en titillant leurs soupirants. St. Mary – la sinistre église en pierre qui surplombait le village – voyait défiler les mariages, et Mann’s Hotel, la salle de réception de la rue principale, n’avait plus un créneau de libre, tant les fiançailles s’enchaînaient, célébrations que les Voyageurs appelaient les « pose-la-question ». L’émission My Big Fat Gipsy Wedding consacra un épisode spécial Noël à cet étrange spectacle.

L’église St. Mary
Rathkeale en décembre
Crédits : Charles Homans
Une personne saine de corps et d’esprit ne visite pas l’Ouest de l’Irlande en décembre. Le soleil se lève tard dans la matinée et reste paresseusement suspendu au-dessus de l’horizon jusqu’au milieu de l’après-midi, fatigué d’essayer de briller à travers les épais nuages jaunâtres qui recouvrent la région. Lorsque je me suis rendu jusqu’à Rathkeale depuis Limerick City en décembre dernier, une semaine avant Noël, il pleuvait. Il a plu tous les jours ensuite. Le paysage – en été, du vert presque bio-luminescent qui donne à l’Irlande cette couleur dont raffolent les touristes – semblait dénaturé, comme si les couleurs avaient été rangées en attendant une météo plus clémente pour se montrer à nouveau.
Juste avant l’heure du loup, au cours mon premier après-midi à Rathkeale, je marchais le long de la grande rue, en admirant les ruines noircies d’une abbaye datant du milieu du XIIIe siècle, lorsque je reconnus l’explosion d’un moteur qu’on démarre. Une Mercedes E350 gris métallisé déboula depuis l’allée qui longeait l’abbaye et dérapa vers la rue principale, soulevant un rideau de fumée sur son passage. Alors que la voiture me passait devant, j’entendis le sifflement admirateur et juvénile d’un des occupants de la Mercedes. En haut de la rue, un groupe de filles qui ne devaient pas avoir plus de 11 ans, emmitouflées dans des manteaux en fausse fourrure, engoncées dans des jeans slim distendus et délavés, et surmontées de coiffures figées par la laque, descendaient la rue chaussées d’improbables talons compensés, en direction d’un lotissement fait de coquettes petites maisons illuminées par des décorations de Noël.
Devant leurs seuils, des caravanes et des 4×4 luxueux dormaient paisiblement. Les Voyageurs avaient commencé à débarquer une semaine avant mon arrivée. La plupart des hommes, appris-je, rejoindraient Rathkeale plus tard, après leurs femmes et leurs enfants. Cela expliquait pourquoi, alors que le soleil abandonnait la bataille, le centre-ville de la petite ville prenait des allures de Pays Imaginaire, où les Enfants Perdus étaient remplacés par de jeunes Voyageurs qui, libérés de l’emprise paternelle, s’apprêtaient à passer la nuit dehors. Tout le monde était sur son trente-et-un et on voyait qu’ils avaient tous fait des efforts pour paraître plus vieux qu’ils ne l’étaient vraiment ; même les petits garçons marchaient avec l’allure d’un adulte sûr de son style et de sa prestance. « Ils sont passés des roulottes aux Porsche et à Beyoncé », me dit Seamus Hogan.
Il n’était pas tout à fait minuit cette nuit-là, et Hogan, un disc-jockey de 44 ans qui faisait bien moins que son âge et passait de la musique sur les ondes locales, était affalé dans un fauteuil en cuir devant la cheminée du lobby de mon hôtel. Le bar voisin accueillait une fête de Noël et les invités, quasiment tous cinquantenaires, erraient dans une salle de banquet en bas du hall, où un groupe reprenait Johnny Cash et Kenny Rogers. « Je me souviens, dit Hogan, quand ils avaient que dalle… » Hogan avait passé toute sa vie à Rathkeale. Je l’avais contacté sur la recommandation de reporters irlandais, pour qui il faisait office de source tout à fait fiable sur toutes les affaires qui secouaient la petite ville. « Roche’s Road, continua-t-il, c’est le berceau de Rathkeale. Il y a environ trente ans, une maison a été vendue à un Voyageur. Et puis l’effet domino s’est mis en place. » Il décompta les quartiers avec ses doigts.
« Puis il y a eu Ballywilliam. Après, c’était Abbeylands, Boherboui, Saint-Mary’s Terrace et Abbey Court. Ils possèdent 95 % des maisons de ces quartiers. » À cet instant, un homme d’une soixantaine d’années, habillé d’un coupe-vent, chauve, les yeux bleus, qui avait un petit air d’Anthony Hopkins, s’éloigna du bar de l’hôtel, une pinte de Carlsberg à la main. « — Paddy ! appela Hogan. C’était quoi la première maison que les Voyageurs ont acheté sur Roche’s Road ? — Celle de Monsieur Lee, répondit l’homme sans hésiter. Numéro 1 sur Roche’s Road. Personne pouvait se l’offrir – sauf les Voyageurs. » Il se joignit à nous et se présenta : Paddy Collins.
« Rathkeale est considéré comme le lieu de recueillement spirituel des Voyageurs, me dit-il. C’est des conneries. Il n’y avait que six familles au début. Beaucoup de ceux qui viennent habiter ici sont des criminels – dire qu’ils sont des Voyageurs, c’est juste une couverture. » Collins était musicien et jouait de la musique irlandaise traditionnelle dans les pubs d’Adage, une ville située un peu plus haut que Rathkeale, très populaire auprès des touristes. À Rathkeale, ajouta-t-il, « on essaie d’accueillir correctement les visiteurs. Et puis on se retrouve avec ça », éructa-t-il, en montrant la rue principale d’un geste dédaigneux. « — C’est trop tard maintenant, dit Hogan. — Ouais », dit Collins.

Le club de boxe de la ville
Main Street, Rathkeale
Crédits : Charles Homans
J’essayai de réorienter la conversation vers les Vagabonds de Rathkeale, ces possédants que je souhaitais mieux cerner, ces hommes qui semblaient être derrière les vols de cornes de rhinocéros et qui étaient la raison principale de ma venue. Mais Hogan et Collins étaient moins intéressés par ce sujet que par ce qu’il se passait simultanément sur la rue principale : un embouteillage de Porsche Cayenne et d’Audi A8, assorti d’un défilé de pépés auto-bronzées, ponctué de petites échauffourées. « Mercredi soir, c’était le pompon, dit Hogan. Ils ont érigé un panneau “pose-la-question” en pleine rue, avec des cônes de chantier tout autour ! Et que fait la Gardai ? Rien du tout ! » L’ascension économico-sociale des Voyageurs de Rathkeale coïncida avec le déclin de leurs voisins sédentaires – et le fait que, pour beaucoup d’Irlandais, le terme « Voyageur » rimait avec pauvreté, alimenta la sensation de vertige qui s’empara du pays lorsqu’il découvrit que ses exclus avaient repris le dessus.
Selon la plupart des estimations, les Voyageurs possèdent désormais 80 % des propriétés de Rathkeale. « Ils dominent pratiquement la région », me raconta Niall Collins, le représentant du comté de Limerick à la chambre basse du Parlement irlandais. « Je suppose que la communauté locale est – je n’ai pas envie d’utiliser un langage polémique, mais elle est mise à l’écart. » Il était difficile de déterminer si les sédentaires de Rathkeale étaient plus perturbés par l’idée que les Voyageurs se fussent enrichis de manière illégale, ou qu’ils se fussent enrichis tout court. La bacchanale incessante qui animait les rues de la commune était le son des Voyageurs qui s’intégraient enfin à une société qui les avait rejetés, alors que tous les autres habitants de Rathkeale perdaient prise tranquillement. Hogan et Collins n’avaient pas tout à fait tort, notamment en ce qui concernait les activités criminelles des Voyageurs.
En 2012, Rathkeale comptait trois fois plus d’actes criminels qu’Adare, une ville voisine qui accueille mille habitants de plus. Je demandai au sergent de police local, Niall Flood, quel était le pourcentage de délit commis par les Voyageurs. « À Noël ? me demanda-t-il. 95 %. » La Gardai avait mis en place un système de patrouille spécial pour la période des fêtes de fin d’année. Rathkeale était loin d’être un mini-État policier – mais la Gardai qui croisait lentement en voiture devant toutes les bandes de jeunes Voyageurs qu’elle croisait donnait à la commune cet aspect « ville occupée » ; il y avait même des points de contrôle aux abords de la commune. « Je n’utiliserais pas le terme “tolérance zéro”, mais on n’en est pas loin, me confia David Sheahan, le sous-préfet du comté de Limerick. Ils doivent comprendre que les choses fonctionnent d’une certaine manière ici. »
Flood accepta de me laisser patrouiller avec lui, et le vendredi suivant, je fis la rencontre de Patrick O’Rourke, l’un des plus jeunes officiers de la police de Rathkeale. Alors qu’O’Rourke manœuvrait son véhicule sur la rue principale, je lui demandai des détails sur la brouille qui pourrissait les relations entre deux familles de Voyageurs. « Ah oui, fit-il, celle qui dure depuis des années… Les jeunes se battent pour des choses qui se sont passées bien avant leur naissance. Parfois, ils viennent avec des crochets et des battes de baseball. » Quoi qu’il en soit, la plupart des crimes commis à Rathkeale était peu spectaculaires.
Douze ans après le coup de couteau que Paddy Sheridan avait donné à David Sheridan, la ville n’avait pas été témoin d’un autre meurtre. Quelques années auparavant, au milieu d’une bagarre, quelqu’un jeta une bombe tuyau par sa fenêtre. On ne déplora aucun blessé. Aucun des policiers que je rencontrai à Rathkeale n’était du coin, et presque tous évoquaient la situation locale avec un détachement digne d’un anthropologue blasé. Pour eux, la ville était une destination plutôt agréable quand on était muté dans l’Irlande rurale ; et c’était un endroit intéressant pour un jeune flic. Depuis que les Vagabonds de Rathkeale étaient sous le feu des projecteurs, les agents et les inspecteurs de tous les pays sollicitaient les policiers locaux pour obtenir des informations, des chiffres, et surtout comprendre les liens familiaux qui unissaient les habitants de Rathkeale, autant d’éléments dont ils avaient désespérément besoin.
En roulant sur la rue principale, O’Rourke me détailla le paysage généalogique que nous étions en train de traverser. « Là, c’est les Sheridan », dit-il, en pointant les maisons plantées de part et d’autre de la rue dans le quartier de Boherboui. « Et là-haut, les Kealy », expliqua-t-il quand nous atteignîmes Roche’s Road, dépassant une immense demeure en brique, gardée par des lions en pierre. Il bifurqua pour se retrouver à nouveau sur la rue principale avant de rejoindre Abbeyland, où les « Bishop » O’Brien vivaient. Plusieurs voitures visiblement très chères étaient garées en bas de la rue ; au volant de son van cahotant, O’Rourke scruta les bolides avec langueur. « BMW X6… bel engin. »
Les responsables du musée de Norwich s’inquiétaient des vols qui avaient lieu dans les établissements de leurs collègues.
La nuit, les rues étaient bizarrement désertes, elles qui étaient si agitées le jour, et tandis que nous traversions le quartier de Ballywilliam, je remarquai que la plupart des histoires qu’on m’avait racontées sur les Voyageurs n’étaient pas bien méchantes. « En fait, ici, me dit O’Rourke, on est assis sur un baril de poudre. Le jour où ça explose, on pourra pas gérer. Et le temps que les renforts arrivent de Limerick, tout sera déjà fini. » Plus je restais à Rathkeale, plus je souhaitais en apprendre sur ceux qui occupaient l’autre bord de l’immense fossé culturel qui scindait la ville en deux. Les Voyageurs que je rencontrai étaient aimables et polis.
Mais dès que je m’identifiais en tant que journaliste, la façade se brisait, et ils s’enfermaient dans un mutisme prudent. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Les histoires de vol de cornes, de générateurs contrefaits et d’arnaques au goudron se multipliant, les Voyageurs locaux étaient sans arrêt scrutés par les caméras de télévision. L’été précédant ma venue, Channel 5, une chaîne irlandaise, diffusa une série de reportages caustiques dans lesquels Paul Connolly, un journaliste d’investigation intrépide, tentait de prouver que les Voyageurs de Rathkeale faisaient partie d’un empire criminel souterrain.
Le premier épisode présenta Connolly debout sur les ruines de l’abbaye de la rue principale, débitant d’une voie grave des propos sur « les ombres qui menaçaient une ville que les Voyageurs souhaitaient totalement contrôler ». Un soir, je me rendis jusqu’au Black Lion, l’un des deux pubs de la ville appartenant à un Voyageur, que les élites de la communauté avait pour habitude de fréquenter. Je me présentai comme journaliste à une vieille femme qui fixait la porte. Elle me dévisagea et rit avec incrédulité, comme si je lui avais proposé un bain de minuit dans la rivière du coin. « Vous avez pas choisi le meilleur moment, me dit son voisin. Y aura aucun Voyageur ici ce soir… »
La porte d’entrée était bloquée par un groupe d’hommes, qui me regardaient d’un air mauvais. Le jour suivant, à la supérette de mon quartier, je me présentai à un homme qui, sa coiffure le trahissait, me semblait être un Voyageur. Il sourit. « Je viens de Liverpool, mon pote », me dit-il, sans même prendre la peine de cacher son accent local. « Je ne fais que passer. »
Le faux pas
Le matin du 20 février 2012, un groupe de conservateurs traversa la galerie d’histoire naturelle du Norwich Castle Museum, dans l’est de l’Angleterre, dans le comté de Norfolk. Peu faisaient partie du personnel du musée ; les autres arrivaient d’une institution similaire à Cambridge. Après avoir dépassé la seule tête de rhinocéros de la collection – installée dans un petit cabinet en acajou bien en vue au cœur de l’exposition En Dehors de l’Afrique, qui présentait des œuvres de taxidermistes de l’époque coloniale – les deux groupes échangèrent leurs impressions.
Le musée de Cambridge avait commencé à recevoir des coups de téléphone étranges au sujet des cornes de rhinocéros présentes dans sa collection, le même genre de coups de fil qui précédaient les vols. Les conservateurs de Norwich leur firent part de leur volonté d’échanger la corne rhinocéros avec une réplique en plastique. Le musée de Norwich présentait de solides atouts, notamment dans le domaine de la sécurité. C’était une forteresse, une vraie, construite par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, alors qu’il mettait la main sur les territoires de l’époque ; d’une hauteur de 21 mètres, le lieu disposait de solides fortifications.
Le château avait résisté à une révolte et une invasion flamande avant de devenir une prison en 1220, pour enfin finir en musée vers la fin du XIXe siècle. L’aile consacrée à l’histoire naturelle – une des nombreuses allées distribuées par une rotonde centrale à la hauteur de plafond impressionnante – demeurait inaccessible après les heures d’ouverture, à moins de forcer la lourde porte d’entrée du bâtiment.

Musée de Norwich
Comté de Norfolk, Angleterre
Crédits
Pourtant, les responsables du musée s’inquiétaient des vols qui avaient lieu dans les établissements de leurs collègues. Deux mois plus tôt, des voleurs avaient aspergé les employés du Musée de la Chasse et de la Nature de Paris avec du gaz lacrymogène et s’étaient enfuis avec des cornes d’Afrique du Sud – la quatorzième tentative de vol de ce type sur le territoire français depuis le mois de janvier 2011. Deux jours après la visite des conservateurs de Cambridge, un jeune couple d’Anglais détourna l’attention d’un gardien du musée de la ville d’Offenburg, en Allemagne, pendant que deux hommes montaient au second étage, où se trouvait une tête de rhinocéros. Avec une masse qu’il avait cachée à l’intérieur de son pantalon, l’un des voleurs grimpa sur le mur où était posée le trophée, et mit de grands coups sur les cornes. Après les avoir récupérées, les deux hommes les dissimulèrent dans leurs vestes, rejoignirent le défilé d’un carnaval catholique qui passait dans la rue, et se volatilisèrent.
Le 20 février était un lundi – jour de fermeture pour la plupart des musées anglais –, et seule une poignée de visiteurs était venue flâner dans les allées de celui de Norwich. En passant dans l’aile dédiée à l’histoire naturelle, les conservateurs avaient remarqué un groupe de quatre hommes, tout de noir vêtus, et qui portaient de larges bonnets sur le crâne. Alors qu’ils savouraient un thé au milieu de la rotonde, les conservateurs virent les quatre hommes sortir de l’aile de l’histoire naturelle et s’avancer vers eux, en direction de la sortie. L’un d’eux courait ; les trois autres avançaient aussi rapidement qu’une personne visiblement chargée d’un gros paquet, en l’occurrence un beau spécimen de taxidermie, aurait pu le faire.
L’un d’eux hurla : « Cassez-vous de là ! » « À ce moment-là », me raconta plus tard l’une des personnes présentes ce jour-là, « on a compris ce qu’il était en train de se passer. » Les voleurs durent passer au plan B. Après avoir forcé la vitre du cabinet d’exposition avec un pied de biche, ils avaient essayé, en vain, d’arracher les cornes de la tête de rhinocéros qu’ils avaient trouvée dans le meuble. Deux choix s’étaient alors présentés à eux : partir les mains vides, ou bien prendre la tête et tenter une chevauchée fantastique jusqu’à la sortie. D’abord pétrifiés par ce spectacle étrange, les conservateurs se demandèrent s’ils allaient se faire gazer à leur tour.
Enfin, l’un des visiteurs de Cambridge se jeta sur l’un des porteurs de tête. Dans l’échauffourée qui suivit, l’un des conservateurs de Norwich fit trébucher un voleur et le trophée roula sur le sol. Pendant un moment, les criminels et les hommes de science se retrouvèrent autour de la tête, immobiles et hésitants, lorsqu’un des conservateurs de Norwich s’empara du trophée et le mit en sécurité. Les voleurs coururent vers la sortie, sautèrent dans une voiture qui les attendait et quittèrent les lieux.
Mahmod se présenta devant le juge deux jours plus tard, et plaida coupable. Il écopa de deux ans et demi de prison.
Vingt minutes plus tard, la police de Norfolk reçut un appel d’un homme qui les informa qu’il se passait quelque chose de bizarre sur Argyle Street, une route sans issue à un peu plus d’un kilomètre du musée. Une Renault Laguna break s’y était garée, le chauffeur en était sorti, avait enlevé les plaques d’immatriculation et était reparti. La description du véhicule faite par le quidam correspondait à la voiture qui avait quitté le musée quelques instants plus tôt, enregistrée par les caméras de surveillance des lieux. Une fois à Argyle Street, les officiers de police récupérèrent les plaques et les firent parler : ils trouvèrent une empreinte digitale sur l’une d’entre elles. Elle appartenait à un homme déjà fiché : Nihad Mahmod, sans-abri irakien de 21 ans et voleur à la petite semaine.
Mahmod réapparut quatre mois plus tard, quand la police de Londres l’arrêta pour une affaire différente, et l’envoya à Norwich, dont les autorités souhaitaient l’interroger. Selon Andy Niham, l’enquêteur qui questionna Mahmod, l’homme admit avoir conduit la voiture qui permit aux voleurs de s’enfuir du musée, mais refusa de donner le nom de ses complices, ni de celui qui les avait embauchés pour accomplir la mission. Cependant, il donna un description précise de l’enchaînement d’événements qui l’avait conduit à accepter ce boulot. Il végétait dans un quartier de l’est londonien quand un homme à l’accent irlandais vint vers lui et lui proposa de gagner de l’argent, vite et bien.
Mahmod accepta, et l’Irlandais le conduisit à Norwich. Ce n’est que sur le chemin qu’il informa le jeune Irakien sur ses véritables intentions. Mahmod se présenta devant le juge deux jours plus tard, et plaida coupable. Il écopa de deux ans et demi de prison. Mais le jour où le verdict fut rendu, les musées anglais avait déjà un autre problème : ceux ou celles qui prenaient un malin plaisir à voler les cornes de rhinocéros avaient visiblement changé de catégorie.
~
Vers 19 h 30, dans la soirée du 13 avril 2012, une alarme retentit dans le Musée Fitzwilliam de l’Université de Cambridge. Quand la sécurité du campus arriva sur les lieux, ils trouvèrent un trou de forme rectangulaire dans le volet métallique qui protégeait l’une des fenêtres de la pièce qui abritait une exposition permanente, Les Arts de l’Extrême-Orient. La vitre avait ensuite été brisée, tout comme les vitrines en verre Securit que les voleurs avaient trouvé sur leur passage, quelques mètres plus loin. Les cabinets fracturés contenaient dix-huit petites reliques, en partie des gravures de jade datant des dynasties chinoises Ming et Qing, que le célèbre collectionneur d’antiquités asiatiques Oscar Raphael avait légué au musée dans les années 1940.
Elles valaient 25 millions de dollars et avaient toutes été volées. Le vol était une frappe chirurgicale, une opération menée à bien en quelques minutes, mais les voleurs avaient été un peu brouillons. La police de Cambridgeshie récupéra rapidement les bandes des caméras de surveillance positionnées à l’extérieur du bâtiment. Elles montraient trois hommes et un adolescent s’approcher du musée quelques temps avant le cambriolage ; une autre caméra les avait filmés en train de garer un van Volkswagen blanc dans une rue adjacente au bâtiment.
La BBC diffusa les images au début du mois de mai, et en moins d’une semaine, deux des suspects furent arrêtés à Londres. L’un d’eux était un Voyageur de 29 ans. Il vivait dans l’est londonien et portait le nom de Patrick Kiely. À Norfolk, Ninham, qui était toujours à la recherche des trois autres voleurs qui dévalisèrent le musée de Norwich, décida de jeter un œil aux bandes récupérées par la sécurité du Fitzwilliam. L’une quatre personnes filmées ce jour-là parut familière au policier ; il avait déjà vu ce gros nez quelque part. Ninham se repassa les bandes qu’il avait visionnées lors de l’affaire du musée de Norwich. Même si les images étaient grises et de mauvaise qualité, « on pouvait largement le reconnaitre, me dit-il. On pouvait le regarder et dire : “Ouais. C’est bien lui.” »

Patrick Kiely
Condamné à dix-huit mois de prison
Crédits : Norfolk Police
Le jour où Kiely comparut devant un tribunal de Norwich, en décembre, il avait déjà été accusé du vol du musée Fitzwilliam et écopé de six ans de prison ; il s’exposait désormais à une peine supplémentaire de dix-huit mois pour la destruction de la tête de rhinocéros. Le juge lui proposa de raccourcir sa peine s’il daignait donner les noms des deux derniers voleurs qui couraient toujours, mais Kiely refusa.
Fidèle à sa stratégie de défense, son avocat rappela que son client avait été forcé de voler ces cornes par des hommes qui avaient menacé sa famille. Lorsqu’il avait échoué la première fois, il dut se rattraper auprès de ses bourreaux et participer au vol de Fitzwilliam. Le juge demeura de marbre. « Si vous pensez que je vais avaler ces salades, vous vous adressez à la mauvaise personne » dit-il. Mais du point de vue de la police, le plus important n’était pas qu’il avait été menacé.
C’était que les deux vols, Fitzwilliam et Norwich, avaient été commandités par les mêmes personnes. Les enquêteurs continuaient de suivre les affaires de vols de cornes de rhinocéros, mais un certain fatalisme finit par remplacer le frisson de l’enquête – en sachant ce qu’il savait sur la destination finale des cornes, personne ne s’attendait à les retrouver en un seul morceau.
Le vol de Fitzwilliam et les gros titres qui suivirent étaient différents. « On en avait quand même pour des dizaines de millions de livres sterling », m’expliqua Ninham – plusieurs fois la valeurs des seules cornes et, surtout, il était cette fois envisageable de remettre la main sur les reliques. « Cela attira l’attention. Et puis, on avait fait un grand pas en impliquant Kiely là-dedans, donc tout se recoupait. » Depuis le début des vols de cornes, la police avait surveillé les Vagabonds de Rathkeale. Il était temps d’agir.
L’assaut
Une heure avant l’aube, le 10 septembre 2013, plusieurs agents du BRC ainsi que des policiers locaux se réunirent silencieusement autour de cinq maisons au cœur de Rathkeale. Dans la ville anglaise de Wolverhampton, une équipe tactique armée de béliers se préparait à faire tomber le portail en fer qui encerclait une maison de brique ; à Belfast, en Irlande du Nord, des officiers peaufinaient les derniers détails d’une descente prévue dans un magasin de tapis sur Castle Street. Et à Cottenham, en Angleterre, des policiers anti-émeute de Cambridgeshire pénétrèrent dans un campement de caravanes et de minibus, un site connu sous le nom de Smithy Fen, souvent fréquenté par les Voyageurs de Rathkeale. Ils recherchaient les propriétaires des maisons à l’intérieur desquelles le BRC venait d’entrer en force. Au signal, le squad de Cambridgeshire descendit dans le camp. « — Police ! cria un home dans une des caravanes.
« — Recule ! cria un flic.
— J’ai la clef ! J’ai la clef ! » hurla vainement un homme alors que la police défonçait sa porte avec une hache et s’engouffrait chez lui.
Selon David Old, l’officier en charge des relations avec la presse de la police de Cambridgeshire, la plupart des dix-neuf personnes arrêtés lors des raids « étaient soupçonnés de conspiration en vue de perpétrer des cambriolages, en liaison avec l’affaire des musées ». Les enquêteurs britanniques refusèrent de donner plus de détails sur les liens qui unissaient les Vagabonds avec leurs interventions. Mais selon un agent du BRC mis au courant de l’opération, le lien entre les voleurs de Fitzwilliam et les Vagabonds était facile à trouver. « Ils s’occupaient des liaisons téléphoniques », me dit-il. Un autre agent du BRC m’apprit que les Vagabonds semblaient passablement choqués par ce qui venait de leur tomber sur la tête.
Pendant des années, dit-il, beaucoup pensaient que ce qui leur valait toute cette attention de la part des autorités était leur goût du bling-bling mis en avant dans My Big Fat Gipsy Wedding. « Ils disaient : “Ces programmes nous causeront des ennuis…”, se souvenait-il. Et nous, on se satisfaisait parfaitement de cette intuition fausse ! » Les Vagabonds étaient étonnés par les efforts mis en œuvre pour retracer leurs pas et comprendre les méandres de leur business et de leurs arbres généalogiques.
Le jour suivant, Michael Slattery embarquait dans un avion à l’aéroport de Newark, dans le New Jersey, quand plusieurs agents du Service de protection de la faune et de la flore, accompagnés par des officiers du Service de l’immigration, l’interpellèrent. Un mois plus tard, la police espagnole appréhenda Daniel « Turkey » O’Brien, en cavale depuis dix-huit mois, dans un aéroport de la ville portuaire d’Alicante, et l’extradèrent vers la Grande-Bretagne. Les deux hommes plaidèrent coupable – de conspiration visant à voler et faire le trafic de faune et de flore, respectivement – et sont aujourd’hui en prison.

Deux Voyageurs arrêtés par la police
Raid de Cambridgeshire
Crédits : SWNS.com
Les suspects arrêtés lors des raids du 10 septembre à Cambridgeshire ne furent pas inculpés tout de suite, et la police ne divulgua pas leurs noms. Mais il permirent à un photographe du journal local, le Cambridge News, de les accompagner lors de leur intervention. Et plus tard ce jour-là, le News publia et mit en forme des extraits des vidéos prises par leur journaliste. Le montage montre un homme massif aux cheveux gris vêtu seulement de ses sous-vêtements, menottes aux poignets et assis sur un sofa, dans une caravane – le même homme qui avait demandé aux policiers d’arrêter d’essayer de défoncer sa porte, puisqu’il avait les clefs. On ne distinguait pas le visage de l’homme, mais dans une vidéo plus longue, publiée peu avant, on pouvait le voir – pas très longtemps, mais assez pour reconnaître Richard « Kerry » O’Brien, l’homme que la presse et la police surnommaient le Roi des Voyageurs de Rathkeale. La maison d’O’Brien faisait partie du lotissement que le BRC avait pris d’assaut ce matin-là à Rathkeale.
À ce moment-là, sa femme, Christina, sa fille Katheleen et ses quatre petits-enfants étaient tous à la maison. Dans la version des faits qu’elle donna au prêtre de la paroisse du coin, Kathleen révéla que les flics, harnachés dans leurs combinaisons anti-émeute, avaient cassé la porte vers 4 h 30, leur crièrent dessus et pointèrent sur eux leur armes à bout pourtant. Les agents du BRC passèrent les heures qui suivirent dans la pièce qui servait de bureau à O’Brien, au milieu de montagnes de documents. Le soleil s’était déjà levé ; les photos qui circulèrent plus tard montraient les agents du BRC sur le parking d’O’Brien, chargeant des ordinateurs et des cartons de documents dans le coffre d’une voiture de police. Lorsque je visitai Rathkeale, trois mois environ après le raid, les suspects de Cambridgeshire avaient été libérés et furent autorisés à rentrer en Irlande.
Les agents du BRC, qui les avaient mis sur écoute, me dirent qu’O’Brien, mais pas les autres, était retourné à Rathkeale en homme libre, pour l’instant. Les autorités, les habitants de Rathkeale et les journalistes irlandais à qui je parlai me confièrent que tenter de l’approcher était au mieux perdu d’avance, au pire carrément dangereux. Il n’avait jamais rien dit à qui que ce soit, et un enquêteur du BRC dit un jour à un autre journaliste qu’il avait été attaqué par des hommes qui lui avaient balancé des briques lorsqu’il avait tenté de s’approcher de la propriété des O’Brien pour prendre des photos. Pourtant, les hommes à qui je m’adressai étaient si vagues qu’aller à la rencontre d’O’Brien semblait être le seul moyen de tenter de s’approcher au plus près de la vérité. Ainsi, le samedi d’avant Noël, lors de mon dernier après-midi en Irlande, j’allai jusque chez lui.
C’était une des plus grandes maisons de la ville, deux étages de briques coloniales avec une coursive blanche, encerclée par un mur de brique et de pierre, et gardée par un portail en fer. Ce dernier était ouvert quand j’arrivai sur les lieux, et plusieurs voitures de luxe ainsi qu’un minivan étaient garés sur le parking. Alors que je sortais de ma voiture, une femme se dirigea vers moi. Elle avait l’air d’avoir une cinquantaine d’années, portait un pull-over rouge, avait teint ses cheveux en blond et les portait attachés vers l’arrière… et semblait très agacée. Je lui demandai si O’Brien était là.
« — Qu’est-ce que vous lui voulez ? me demanda-t-elle.
— Je voudrais lui poser des questions sur les cornes de rhinocéros », répondis-je. Elle me fixa un long moment. Deux hommes patibulaires aux cheveux gris, remarquai-je, était sorti de la maison. « Il n’est pas là », finit-elle par me dire avant de retourner à l’intérieur.
~
Un mois plus tard, le gouvernement irlandais était secoué par un scandale impliquant un abus de pouvoir parmi les hauts gradés de la Gardai, et en février, le premier ministre Endra Kenny fut obligé de répondre à un certain nombre de questions, demandant dans un discours à ce que « quiconque possédait des informations pertinentes » concernant les méthodes peu orthodoxes de la police nationale était prié de les rendre publiques. La semaine suivante, un site WordPress apparut. « Je suis prêt à fournir de telles preuves à Monsieur Kenny, disait un internaute. Mon nom est Richard Kerry O’Brien. »
Son témoignage semblait un peu naïf ; il décrivait les raids du mois de septembre, mentionnait des détails qui, à ma connaissance, n’étaient jamais sortis dans la presse – seuls des officiers me firent part de précisions pareilles, et ceux-ci étaient tous présents lors des raids. « Selon moi, écrivait O’Brien, le harcèlement systématique que j’ai subi était la conséquence directe des fantasmes de la Gardai au sujet des Voyageurs. Dès que l’un d’entre nous possède une jolie voiture ou une jolie maison, il est suspect. Le Voyageur raffiné est toujours suspect. » À la fin de son post, il y avait une adresse Gmail. Je décidai de lui écrire immédiatement. O’Brien me répondit dans l’heure. « Content de voir que les USA s’intéressent à cette histoire », écrivait-il, après s’être excusé du traitement qui m’avait été réservé en décembre, devant chez lui.
« Pardon si ma femme s’est montrée un peu impolie, continuait-il. Nous ne nous comportons jamais comme cela avec les visiteurs. » Quand je l’appelai sur le numéro qu’il m’avait donné, l’homme qui répondit – la voix était ferme mais pas inamicale – me dit que j’étais le premier journaliste à qui il allait parler. Je lui demandai pourquoi il acceptait de le faire. « Je n’en peux plus », dit-il, avant de me questionner sur ce que la police avait bien pu me dire à son sujet. Quand je lui parlai de l’arrestation de son fils dans le Colorado, il semblait alors clair que l’homme au bout du fil était O’Brien – ou bien l’homme avait lu les centaines de pages consignées par de nombreuses cours de justice dans divers pays, tant il maîtrisait son sujet. Je réservai un billet pour l’Irlande et m’y rendis dans l’après-midi.
La confession
Quand je sortis du bus qui m’avait conduit à Rathkeale, quatre jours plus tard, un homme bâti comme un tonneau se tenait appuyé contre une Volkswagen Golf grise garée sur le côté de la route. Ses cheveux poivre et sel encadraient un large visage. Il était vêtu d’un costume rayé noir sur une chemise violette au col large, cravate assortie, nouée en double Windsor. Il me sembla improbable, lorsque je posai enfin mes yeux sur lui, que Richard O’Brien était l’homme qu’on m’avait tant décrit. Le parrain d’un réseau criminel international n’arriverait jamais à un rendez-vous avec un journaliste vêtu comme le parrain d’un réseau criminel international.
« Je n’ai jamais rien eu à voir avec des cornes de rhinocéros », me dit O’Brien juste après avoir garé sa Golf devant chez lui. Les habitants de Rathkeale, ainsi que la police locale, décrivaient la maison avec des termes un peu ampoulés, à la manière dont quelqu’un du comté de Wetchester décrirait le manoir Rockfeller. De l’extérieur, elle avait l’air impressionnante et imposante, mais lorsqu’O’Brien me fit visiter l’intérieur, je me rendis compte qu’elle était plus petite que la plupart des maisons des zones extra-urbaines que j’avais pu visiter en Amérique du Nord.
Elle ressemblait à une maison-témoin – le canapé et les fauteuils en cuir blanc étaient recouverts de plastique, et il y avait peu d’objets de décoration, à part quelques photos de famille et des figurines catholiques. Deux amis d’O’Brien, la cinquantaine, étaient assis à une table en granit, sur laquelle sa femme avait posé des assiettes garnies de cookies et de pain. Derrière une porte mi-close qui donnait sur une petite pièce derrière la cuisine, je pouvais entendre les sons étouffés d’un dessin-animé et de ses jeunes spectateurs. « Je ne viens pas d’ici, en fait, me dit O’Brien, une fois installé autour de la table. En fait, ajouta-t-il, je ne suis pas vraiment un Voyageur. »

Richard « Kerry » O’Brien
À Rathkeale en mars 2014
Crédits : Charles Homans
Il me raconta qu’il était arrivé dans la communauté par l’entremise de Christina, qui était de la famille Flynn, une des plus vieilles familles de Voyageurs de Rathkeale. Lui était de Kanturk, dans le comté de Cork. « On n’avait pas d’argent », dit-il, et il quitta sa maison à 16 ans pour tenter de gagner sa vie. Il finit par vendre des antiquités, et il était plutôt bon dans le domaine, mais le rythme des journées et l’imprévisibilité du travail l’agaçaient. « J’aime bien acheter des choses un jour et les revendre le lendemain, faire un peu d’argent rapidement, dit-il. Dans le business des antiquités, t’achètes ça – il désigna la table. Ce commerçant va peut-être l’aimer, et le chèque qu’on te donnera sera refusé par la banque. Trop de problèmes. »
O’Brien réalisa qu’il y avait plus de profit à faire en tirant parti du boom de l’immobilier qui avait pris l’Irlande par surprise à cette époque-là. Après avoir acheté puis revendu son usine d’aluminium du comté de Cork, il commença à se lancer dans l’import de marchandises chinoises. « Tu vois cette lampe ? » me demanda-t-il, pointant celle qui illuminait son parking. « Je les avais à 270 $ en Chine », dit-il, et il les revendait quatre fois le prix en Irlande. À la fin des années 1990, c’était un habitué du salon annuel du commerce de Guangzhou, « le plus important du monde – ça te prenait quatre jours pour en faire le tour. » Il cherchait des usines au Vietnam, en Malaisie, en Indonésie – « je suis resté trois mois dans la jungle indonésienne, une fois », se souvint-il.
Quand le marché des meubles de salon importés commença à fléchir, en accord avec l’implosion du marché immobilier irlandais, O’Brien changea de trajectoire, une fois de plus ; maintenant, il n’allait importer que des meubles comme ceux qu’il possédait lui-même, encore aujourd’hui, bien en vue dans sa véranda. Enfin, je parvins à lui faire part des rumeurs et des accusations qui couraient à propos de son business, recueillies auprès d’enquêteurs chevronnés. O’Brien m’assura qu’il ignorait tout des vols de cornes de rhinocéros et des braquages de musée, événements qui poussèrent la police à forcer sa porte.
Après avoir été jeté sur son parking, menotté et dévêtu, puis amené au poste de police de Cambridgeshire, il m’expliqua avoir confié aux policiers « n’avoir jamais mis les pieds dans un musée ». Les policiers qui interrogèrent O’Brien s’intéressaient surtout à ses voyages en Chine et au Vietnam – ce qu’il y faisait, qui il voyait.

On prête aux cornes des vertus médicales
Réduites en poudre, elles sont vendues en Asie
Crédits
Quand ils lui rendirent son passeport, me dit-il, ses visas vietnamiens avaient été enlevés sans explication. Pourtant, me confia O’Brien, « c’étaient des gens civilisés. Ils m’ont donné du café et du thé. » Il était davantage remonté contre la police irlandaise, qui avait organisé le raid contre sa maison à Rathkeale et, dit-il, avaient pointé leurs armes sur sa femme et ses enfants. « Ils couraient dans la maison comme s’ils braquaient une banque, tu vois ce que je veux dire ? » (Des représentants des agents du BRC et de la police de Cambridgeshire refusèrent de commenter ces allégations.)
Quand je l’interrogeai sur les affaires de son fils, qui trempait dans le commerce des cornes de rhinocéros, aux États-Unis, O’Brien me dit qu’il ne comprenait pas ce qu’il se passait depuis l’arrestation de Richard Jr. Dans tous les cas, me dit-il, l’arrestation de son fils était « un coup monté. Cela ne serait jamais arrivé ici, en Europe. Il serait sorti vainqueur du procès. Mais, tu sais, en Amérique, ça coûte cher, un procès. Il aurait pu gagner, mais ça aurait duré un temps fou… » De plus, m’avoua-t-il, « ce qu’il a fait… c’est pas illégal d’acheter une corne de rhinocéros, quand on a les bons papiers. »
Il disait vrai : il était possible d’acheter des cornes de rhinocéros sous réserve d’avoir les bonnes autorisations. Mais Richard Jr et Michael Hegarty étaient loin des les avoir – un fait dont ils étaient au courant quand ils se rendirent chez Curtis Graves. Je lui fis remarquer que son fils et son gendre avaient été enregistrés en train de parler de la possibilité d’enfreindre la loi. « Il décrit la méthode qu’ils vont utiliser pour transporter les cornes en Europe », dis-je. « Ils n’ont jamais dit ça », me répondit O’Brien. Je lui dis que je l’avais moi-même lu, dans une retranscription faite par les agents du gouvernement, et que je pouvais lui fournir une copie. « Peut-être, j’en sais rien, dit-il. Peut-être qu’il a dit ça. » Pourtant, ajouta-t-il, « j’étais pas en contact avec lui du tout. Il avait 27 ans à l’époque. J’ai quitté mes parents à 16. Il a payé ses dettes, et c’est tout. »
Après avoir parlé deux bonnes heures, O’Brien me proposa de visiter le cimetière. Les cimetières sont les seuls lieux susceptibles d’enraciner les Voyageurs irlandais quelque part. À Rathkeale, les familles les plus riches avaient érigé des tours de marbre, de granit et de feuilles d’or, et elles étaient connues pour porter les cercueils de leurs défunts dans des carosses de verre tirés par des chevaux noirs. Nous montâmes dans la Volkswagen, avec Michael, son petit-fils âgé de 11 ans, assis à l’arrière – le fils de Michael Hegarty. O’Brien quitta la ville, suivit une route qui passait sous un pont, et s’arrêta sur un petit parking. Un orage récent avait fait tomber quelques arbres, qui séparaient le cimetière de la route ; au-delà des racines exhumées par le vent et des flaques de boue s’étendait une forêt de marbre, de Vierges, de saints et de crucifix.
O’Brien répondit à son téléphone, et Michael me mena à travers les pierres tombales. Sous les stèles impeccablement tenues gisaient les Flynn, les Quilligan, les O’Brien et les Slattery. Michael me montra la tombe d’un certain David « Tunny » Sheridan. « Lui là, il a été tué devant mon frère, me dit-il. Avec un tournevis. » Il me montra une autre parcelle – « Là, y’a mon oncle. » Une pietà de bronze, drapée d’un rosaire, se tenait au milieu d’un cœur brisé en granit noire, flanqué des statues de Jean Paul II et Saint-Antoine. « Je déménage après Pâques », me confia O’Brien après avoir raccroché. Quitter l’Irlande – pour la France, peut-être.
« Je dois partir. Ma femme ne veut plus vivre dans notre maison désormais. Je fais mes valises et je laisse tout. Parce que tu ne peux pas discuter tranquillement quand tu sais que ta maison est truffée de micros, tout comme tes voitures – je peux le prouver. Mon fils paye sa dette, mais il n’a tué personne, il n’a pas braqué une banque. Je ne peux pas décrire la manière dont on est traité ici… Comme des Juifs traités par Hitler. » Quand nous revînmes dans le centre de Rahtkeale, je remerciai O’Brien et commençai à marcher vers Main Street. Quelques minutes plus tard, la Golf s’arrêta à côté de moi. « Écrivez bien ça, me souffla O’Brien. On nous traite comme Hitler traitait les Juifs. »
~
O’Brien et celles et ceux qui furent arrêtés en septembre devaient pointer au commissariat de Cambridgeshire en avril suivant. Mais bien que six mois ont passé depuis les arrestations, les autorités n’ont toujours pas donné d’indications quant aux chefs d’accusation – et O’Brien avait donc encore raison : aucune preuve ne démontrait qu’il était une espèce de parrain de la mafia, ici à Rathkeale. Dans le vol de retour vers New York, je commençai à me demander s’il ne pouvait pas tirer un quelconque prestige de toute cette affaire – une affaire comme celle des vols de cornes supposait que son architecte était un homme d’une intelligence rare.
Dans sa pièce safari, il constata qu’il manquait la corne sur sa tête de rhinocéros.
Au pub à Dublin, j’avais demandé à Eamon Dillon ce qu’il pensait de la fascination des Irlandais pour les Vagabonds de Rathkeale. « On aime ce qui est brut en Irlande, avait-il répliqué. C’est universel – les gens adorent les as de l’arnaque. » Les deux agents du BRC rencontrés en décembre étaient convaincus qu’ils ne résoudraient pas l’affaire des vols de cornes. Quand je leur fis remarquer que les cambriolages avaient cessé – plus un depuis l’affaire des Swords huit mois plus tôt – l’un d’eux intervint.
« — Oui, c’est vrai, dit-il. On a peut-être atteint le pic.
— Ce serait pas mal, oui », ajouta l’autre agent.
Un mois et demi plus tard, je reçus un matin une notification de l’Irish Independent dans ma boîte mail, accompagnée d’une courte introduction signée John Reid, d’Europol. « Vous avez dû déjà tomber dessus. » Le lundi précédent, Michael Flatley, l’impresario de Riverdance, jouait aux jeux vidéo avec son épouse et son fils dans son manoir du comté de Cork, quand il entendit un bruit en provenance d’une autre pièce de la maison. Il regarda par la fenêtre et vit quatre hommes vêtus de noir courir à travers son gazon vers le parking, sauter dans une voiture et s’enfuir. Ils avaient déjoué le système de sécurité de la propriété et pénétré dans la « pièce safari » de Flatley, où il conservait sa collection de trophées. Le Lord of the Dance les poursuivit avec sa voiture de sport.
Lorsqu’il arriva au bout de sa propriété, les voleurs étaient déjà partis, et il retourna chez lui pour inspecter les dégâts. Dans sa pièce safari, il constata qu’il manquait la corne sur sa tête de rhinocéros.
Traduit de l’anglais par Benoit Marchisio d’après « Dead Zoo Gang », paru dans Atavist. Couverture : Les falaises d’Irlande de l’ouest. Création graphique par Ulyces.